|
|
[ Photos ] [ Soufisme-citations ] [ DIWAN ] [ Questions à la Tijaniyya ] [ Informatique ] [ Rappels&Sagesses ] [ Fiqh-Jurisprudence ] [ Al-Hissane ] [ hadiths ]
|
|
|
| |
Est-ce le cerveau ou le cœur qui est le siège de la raison ?
04/02/2008 14:06

Est-ce le cerveau ou le cœur qui est le siège de la raison ?
Trois questions :
1) Que signifie le verset coranique : "des cœurs par lesquels ils raisonnent ou des oreilles par lesquelles ils écoutent" ?
2) Est-ce le cerveau ou le cœur qui est le siège de la pensée, de la réflexion et du raisonnement ?
3) Est-ce le cœur ou le cerveau qui est le siège des émotions, des sentiments et des qualités spirituelles ?
Réponse :
Ce qu' il faut dire c'est que, même à discuter du lieu où elles se trouvent et des mécanismes par lesquels elles s'expriment, on ne peut nier l'existence chez l'homme des deux facultés de la "raison" et du "cœur".
En effet, ces deux termes renvoient à des réalités connues et répertoriées, quelle que soit leur localisation : dans la poitrine (le muscle cardiaque) ou dans le cerveau. Le terme « raison» désigne ainsi la faculté humaine de comprendre, de raisonner et de penser ; le mot «cœur » exprime quant à lui la faculté d'aimer, de détester et d'émettre des critères éthiques.
Ce rappel effectué, nous pouvons maintenant aborder la question de la localisation de ces deux facultés que sont "le cœur" et "la raison"…
1) Est-ce le cerveau ou le cœur qui est le siège de la pensée, de la réflexion et du raisonnement ?
Cette question a fait l'objet, comme l'a rappelé an-Nawawî, d'une divergence d'avis bien connue entre les savants musulmans.
Un certain nombre de savants disent que la faculté de raisonnement se trouve dans le cœur (ici dans le sens de muscle cardiaque) et non dans le cerveau : il s'agit entre autres de Mujâhid, de Ibn Hajar (Fat'h ul-bârî, commentaire du hadîth n° 52 rapporté par al-Bukhârî), et, d'une façon plus générale, des savants de l'école shafi'ite (Shar'h Muslim, commentaire du hadîth n° 1599). Plus récemment, un savant comme al-Albânî (mort en 1999) pensait de même : raisonner et penser, écrit-il, sont des actes du cœur qui se trouve dans la poitrine, et non du cerveau qui se trouve dans la boîte crânienne ; al-Albânî se fonde pour cela sur les versets suivants du Coran : «Ils ont un cœur (mais) ne comprennent pas par son moyen» (Coran 7/179).
«N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'avoir des cœurs par lesquels ils raisonnent, ou des oreilles par lesquelles ils écoutent ? Car ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent, mais s'aveuglent les cœurs qui sont dans les poitrines » (Coran 22/46).
Voyez, dit al-Albânî : ces versets disent bien que c'est le cœur qui comprend et qui raisonne ; or, souligne-t-il, le «cœur » ne peut être compris comme désignant le cerveau, car la fin du verset dit explicitement qu'il se trouve dans la poitrine (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, tome 6 p. 468).
D'autres savants pensent pour leur part que la faculté de penser, de comprendre et de raisonner se trouve dans le cerveau. Parmi ces savants se trouve Abû Hanîfa (voir Shar'h Muslim, commentaire du hadîth n° 1599). Et cet avis est également relaté de Ahmad ibn Hanbal ("Wa qad yurâdu bil-qalbi : bâtin ul-insân mutlaqan (...). Fa idhâ urîda bil-qalbi hâdhâ, fal-'aqlu muta'alliqun bi dimâghihî aydhan ; wa lihâdhâ qîla : "Inna-l-'aqla fid-dimâgh", kamâ yaqûluhu kathîrun min al-atibbâ', wa nuqila dhâlika 'an il-imâm Ahmad" : Majmû' ul-fatâwâ, Ibn Taymiyya, tome 9 p. 303).
J'ai questionné Cheikh Khâlid Saïfullâh au sujet du premier avis et de l'argumentation sur laquelle il repose, il m'a répondu en substance que d'une part il est aujourd'hui démontré scientifiquement que la faculté de raisonnement se trouve dans le cerveau, et que d'autre part il y a depuis les premiers siècles de l'Islam deux avis chez les savants. "Je pense donc que dire le contraire serait contraire à ce qu'a prouvé l'observation ("mushâhadé ké khilâf")" a-t-il conclu.
Comment, me direz-vous, comprendre alors les deux versets coraniques sur lesquels les tenants du premier avis ont fondé celui-ci ?
Nous allons y revenir dans les points 2 et 3, à travers les explications de al-Ghazâlî, de Shâh Waliyyullâh et de al-Jûzû.
2) Est-ce le cœur ou bien le cerveau qui est le siège des émotions, des sentiments et des qualités spirituelles ?
D'après les savants musulmans, d'après aussi les poètes et les mystiques occidentaux, c'est le cœur qui est le siège des émotions, des sentiments, des critères éthiques et des qualités spirituelles.
A cela des scientifiques occidentaux contemporains objectent que le cœur n'est qu'un muscle qui fait office de pompe envoyant le sang dans le reste de l'organisme. D'après ces scientifiques, c'est plutôt le cerveau qui est le siège de sentiments et de qualités ; et ce qu'on nommait auparavant "émotions" et "valeurs" n'est en fait que l'expression de gènes, d'hormones et de connexions entre neurones (comme l'a écrit Jean-Pierre Changeux)…
Mais en fait il faut nuancer ce propos. En effet, que le cœur soit un muscle servant à envoyer le sang dans tout le corps par l'intermédiaire des artères, on le sait en Occident depuis 1648 avec Harvey (en terre musulmane, la petite circulation du sang avait été mise en évidence 400 ans plus tôt, par Ibn an-Nafîs ; cf. Le soleil d'Allah brille sur l'Occident, Sigrid Hunke, pp. 152-155). Certes. Mais que le cœur soit une pompe pour le sang n'implique pas qu'il ne puisse pas être plus que cela.
– Déjà il faut dire que pour le savant musulman al-Ghazâlî, "le cœur" dont parlent le Coran et la Sunna en tant que siège des qualités n'est à proprement parler pas le muscle cardiaque mais l'âme humaine. Il écrit : "Lorsque nous employons le mot "cœur" dans cet ouvrage, nous n'entendons pas désigner [le muscle cardiaque]" (Al-Ihyâ', tome 3 p. 5) mais l'âme humaine (c'est ce qu'implique ce qu'il a écrit dans les lignes et les pages suivantes). Al-Ghazâlî souligne que quand "il est employé dans le Coran et la Sunna" également, le mot "cœur" désigne aussi l'âme humaine ; de plus, cette âme humaine y est parfois désignée par les termes : "le cœur qui se trouve dans la poitrine" (Idem, p. 7). Malgré tout, précise al-Ghazâlî, "il y a un lien particulier entre cette âme, qui est immatérielle, et le cœur physique" ; en fait, souligne-t-il, l'âme est liée à tout le corps, de même qu'elle donne des influx à tout le corps, mais son lien avec le cœur est de nature particulière (Al-Ihyâ', tome 3 p. 4 et p. 7).
Les qualités, les critères éthiques, les sentiments, se trouvent dans l'âme (voir Hujjat-ullâh il-bâligha, Shâh Waliyyullâh, tome 1 pp. 66-67) ; or l'âme ayant un lien avec tout le corps mais particulièrement avec le cœur physique, ce dernier serait une sorte de réceptacle de ces qualités et sentiments.
Ces tentatives d'explications ne sont scientifiquement pas impossibles. Une américaine, Claire Sylvia, relate : "En 1988, alors que je suis presque mourante, atteinte d'une maladie grave et fatale, on m'ouvre la poitrine et on m'en extrait le cœur et les poumons. Dans une tentative désespérée de me sauver la vie, les médecins transplantent, dans cet espace vide et creux, les organes d'un jeune homme qui vient de mourir dans un accident de moto. (…) En me réveillant de l'opération, je pense que mon long voyage est enfin parvenu à son terme. En fait, il ne fait que commencer. Très rapidement, je sens que j'ai reçu bien davantage que simplement deux organes. Je commence à me demander si le cœur et les poumons transplantés ne portent pas en eux leurs propres inclinations et souvenirs. Je fais des rêves et constate des changements qui semblent suggérer que certains aspects de l'esprit et de la personnalité du donneur existent à présent à l'intérieur de moi" (Mon cœur est un Autre - Le miracle des greffes, le mystère de la mémoire cellulaire, Claire Sylvia, Jean-Claude Lattès pour la traduction française, 1998, pp. 13-14). ""Le cœur n'est rien d'autre qu'une pompe." Telle est la vision de la médecine contemporaine. Je précise "contemporaine" parce que jusqu'au XVIIè siècle, le cœur n'était pas du tout considéré comme une pompe. Dans l'Antiquité, on le voyait comme le centre de la sagesse et de l'émotion. (…) En 1648, lors d'une des plus importantes découvertes de l'histoire de la médecine, le médecin anglais William Harvey proclamait au monde que le cœur, au travers d'une série continuelle de contractions, pompait le sang qui circulait dans le corps pour revenir à sa source. Aujourd'hui personne ne le conteste, mais reconnaître l'évidence – à savoir que le cœur est une pompe – ne revient pas à affirmer que c'est uniquement une pompe. Comme nous le verrons, certains scientifiques croient que le cœur est peut-être bien davantage" (Idem, pp. 259-260). "Toute ma vie on m'a affirmé, en dépit des protestations des poètes et des convictions des mystiques, que le cœur humain n'était qu'une pompe. Une pompe incroyablement importante, certes, mais rien de plus qu'une machine monotone et indispensable. Conformément à ce point de vue, qui est celui généralement accepté par la médecine occidentale contemporaine, le cœur ne contient aucun sentiment et n'abrite aucune sagesse, aucune connaissance et aucun souvenir. Et si celui d'une personne a précédemment résidé dans le corps d'une autre, cela ne présente aucune signification ou implication particulière. Je croyais à ces idées, mais aujourd'hui je sais qu'il en va autrement. Peut-être y a-t-il d'autres façons d'envisager les choses. Peut-être certaines des nombreuses qualités attribuées au cœur depuis des siècles ne sont pas seulement métaphoriques. Même aujourd'hui, à une époque éclairée et scientifique, nous invoquons encore notre cœur pour décrire nos sentiments et nos valeurs. Lorsque l'amour meurt ou que la mort frappe, nous disons que notre cœur est brisé. Nous prenons à cœur ou nous n'avons pas à cœur de faire quelque chose. Si l'on est généreux, on a le cœur sur la main. Si l'on est insensible, on est sans cœur. Cœur pur, cœur gros, cœur sensible, cœur dur, cœur noble, cœur tendre, cœur d'or ou de pierre – la liste est longue. Ces expressions recèleraient-elles une vérité littérale ? Même les cardiologues les plus conservateurs reconnaissent que la santé et le fonctionnement du cœur sont affectés par certaines réalités émotionnelles telles que la solitude, la dépression ou l'aliénation. Et s'il est communément accepté que l'esprit et le corps sont profondément liés, il n'existe pas autant d'images ou d'expressions se référant au foie, au pancréas ou même au cerveau" (Idem, p. 15).
– D'un autre côté, l'âme humaine semble être liée de façon particulière au cerveau aussi. Un savant musulman indien, Mujâhid ul-islâm Qâssimî, écrit : "On sait maintenant que la mort humaine est liée de façon essentielle à la mort du cerveau : la mort survient quand meurt la partie du cerveau que l'on nomme "le tronc cérébral". (…) L'arrêt des battements du cœur entraîne l'arrêt de la circulation sanguine, ce qui arrête l'irrigation du cerveau en sang. Sans être irrigué en sang, le cerveau ne peut demeurer vivant que quelques quatre ou cinq minutes. (…) Et lorsque le cerveau meurt, alors même si on maintient pour un moment les battements du cœur de façon artificielle, l'homme ne peut revenir à la vie. Au contraire du cas où le cerveau est vivant : même si les battements du cœur s'arrêtent pendant quelques minutes, du moment où le cerveau reste irrigué en sang [par une machine], alors l'être humain est toujours vivant" (Dimâghî mawt o hayât kâ mas'ala, p. 5). Mujâhid ul-islâm poursuit : "C'est pourquoi les médecins disent que le centre de l'âme humaine se trouve dans le cerveau (…) ; c'est le cerveau qui est le centre de la pensée, et c'est lui qui donne aux membres du corps les influx leur ordonnant de faire telle ou telle chose" (Idem). "On dit que c'est cette partie du cerveau [le tronc cérébral] qui est le centre de la conscience humaine" (Idem). Plus loin il écrit : "La mort survient quand le tronc cérébral meurt ; d'après les savants musulmans, elle survient quand l'âme quitte le corps. (…) On peut concilier ces deux perceptions en disant que l'âme, qui est immatérielle, n'est pas l'objet des investigations scientifiques de la médecine, contrairement au cerveau, qui, lui, est matériel. (…) L'âme agit sur le corps par l'intermédiaire du tronc cérébral, qu'elle prend comme centre. Mais quand le tronc cérébral meurt, l'âme le quitte" (Idem, pp. 7-8).
– Serait-il possible de proposer la synthèse suivante : d'un côté, comme l'a écrit Shâh Waliyyullâh, c'est dans le premier niveau de l'âme – confluent entre le corps et le niveau supérieur de l'âme – que se localisent les qualités et les sentiments profonds ; or, comme l'a écrit al-Ghazâlî, l'âme a un lien particulier avec le cœur physique ; le cœur serait donc une sorte de réceptacle des qualités et des sentiments. D'un autre côté, comme l'a écrit Mujâhid ul-islâm Qâssimî, l'âme a aussi un lien d'attache particulier avec le cerveau. Dès lors, l'explication pourrait-elle être la suivante : l'âme humaine agit sur le corps par l'intermédiaire du cerveau, mais tout ce qu'elle recèle en elle a pour réceptacle le cœur physique. L'âme serait donc liée de façon particulière au cerveau et au cœur. Cette synthèse est-elle possible ? Prière aux frères et sœurs compétents d'en faire une critique constructive.
3) Le cœur avec lequel l'homme raisonne :
Selon les explications citées ci-dessus, la faculté humaine du "cœur" n'est pas la même chose que celle de la "raison" : le cerveau est le siège de la pensée, tandis que le cœur est le réceptacle des sentiments et des qualités. Le Coran utilise cependant une formule originale, qui mêle les deux termes : il exhorte les hommes à avoir "un cœur par lequel ils raisonnent" : "N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'avoir un cœur par lequel ils raisonnent ou des oreilles par lesquelles ils écoutent ?" (Coran 22/46). Comment comprendre cette formule ?
Pour al-Jûzû, le cœur et la raison ne sont en effet pas une seule mais deux facultés différentes. Cependant, selon lui, le cœur et la raison ont chacun leur intelligence : comme le cerveau raisonne, le cœur a son intelligence propre ; les deux modes de raisonnement sont différents, mais ils ne sont pas antinomiques. Et le Coran exhorte donc les hommes à utiliser l'intelligence de leur cœur pour appréhender les choses de l'univers, comme ils utilisent d'habitude le raisonnement de leur raison pour le faire (voir Maf'hûm al-'aql wal-qalb fil-qur'ân was-sunna, al-Jûzû, pp. 275 et suivantes).
Pour Shâh Waliyyullâh également, le cœur et la raison ne sont pas une seule mais deux facultés différentes (Hujjat ullâh il-bâligha, tome 2 p. 235 et p. 273). Cependant, à la différence de al-Jûzû, pour Shâh Waliyyullâh seule la raison raisonne, et si le Coran et la Sunna attribuent parfois au cœur les qualités qui relèvent en fait d'autres facultés, c'est qu'ils utilisent parfois ce terme "cœur" d'une façon large (tassâmuh) : il s'agit de l'intérieur de l'homme [il est à noter que Ibn Taymiyya a également écrit la même chose, relatant que c'est là un des sens que revêt parfois le terme "cœur" : Majmû' ul-fatâwâ, tome 9 p. 303]. Le Coran et la Sunna attribuent donc au "cœur", dans un sens figuré, de nombreuses qualités, qu'il s'agisse de qualités qui sont réellement celles du "cœur" ou qu'il s'agisse en fait de celles de la "raison" ou encore de celles relatives aux pulsions corporelles naturellement présentes chez l'homme (Idem, p. 273).
Serait-il possible de proposer l'humble explication suivante : comme l'ont écrit Shâh Waliyyullâh et al-Jûzû, "cœur" et "raison" sont deux facultés différentes. Mais à la différence de ce que al-Jûzû a écrit et en conformité avec ce que Shâh Waliyyullâh a expliqué, seule la raison raisonne, tandis que le cœur, lui, est le réceptacle des sentiments et des qualités. Serait-il possible alors de dire que ce que ce verset demande à l'homme, c'est que lorsqu'il pense avec sa raison, il le fasse avec l'accompagnement de son cœur ; que sa raison agisse en s'orientant de ce que lui souffle en amont le cœur ? En fait tout repose sur la compréhension de la particule "bâ'" ("bi") employée dans le verset : "qulûbun ya'qilûna bi hâ" : l'explication de al-Jûzû semble reposer sur l'avis qu'il s'agit d'une particule exprimant le moyen ("ba' al-isti'âna") ; mais pourrait-il s'agir d'une particule exprimant l'accompagnement ("bâ' al-mussâhaba") ? Selon l'explication de al-Jûzû, il serait question de raisonner par le moyen du cœur même. Dans le cas où il s'agirait d'une particule exprimant l'accompagnement, il serait question de raisonner par sa raison mais avec l'accompagnement du cœur. Ce n'est qu'une tentative d'explication. Est-elle possible ? Prière aux lecteurs et lectrices compétents d'en faire une critique constructive.
En tout état de cause et quelle que soit l'explication retenue, le résultat est le même. Est-ce que le cœur humain a son raisonnement propre, différent de celui de la raison, le verset exhortant alors les hommes à utiliser le raisonnement de leur cœur comme ils utilisent d'habitude celui de leur raison ? Ou bien est-ce que seule la raison raisonne, le verset exhortant alors les hommes à raisonner par leur raison mais avec l'accompagnement de leur cœur ? Le Coran évite ce genre d'explications abstraites pour aller à l'essentiel et aborder le côté concret des choses. Et cet essentiel est de rappeler aux hommes que leur faculté d'appréhender les réalités du monde ne doit pas être l'œuvre d'une raison pure et froide, mais d'une intelligence du cœur… d'un "cœur par lequel ils raisonnent". Cette formulation fait apparaître une nouvelle dimension au raisonnement humain : il est demandé à l'homme d'avoir une intelligence active mais qui ne se limite pas à un côté des choses ; d'avoir une intelligence où la pensée et le sentiment se trouvent en interactivité ; d'avoir une intelligence où la réalité matérielle comme la réalité spirituelle sont prises en compte... Il est demandé à l'homme de développer en soi un mode de raisonner où la mécanique de la raison se trouve accompagnée par la chaleur des sentiments et de la spiritualité.
Des écrits de Ibn Taymiyya sur le sujet :
Après avoir proposé mon humble réflexion concernant le fait que l'âme est liée aussi bien au cerveau qu'au cœur, j'ai découvert que Ibn Taymiyya avait en fait écrit la même chose : "Wat-tahqîq anna-r-rûha – al-latî hiya-n-nafs – lahâ ta'aluqqun bi hâdhâ [al-qalb] wa hâdhâ [ad-dimâgh] ..." (Majmû' ul-fatâwâ, tome 9 p. 304). Je suis heureux d'avoir découvert cet écrit confirmant mon humble réflexion. Wal-hamdu lillâh 'alâ dhâlik.
Concernant le fait que l'intelligence humaine est liée au cerveau comme au cœur, je n'ai pas trouvé un texte approuvant ce que j'ai proposé, à savoir que la particule bâ' exprimerait peut-être l'accompagnement et que seul le cerveau raisonne, mais l'islam lui demande demande à l'homme de le faire avec l'accompagnement du cœur ; l'écrit de Ibn Taymiyya sur le sujet ne confirme pas ce que j'ai proposé, néanmoins le résultat concret est assez proche : lui écrit que le raisonnement est lié à la fois au cerveau et au cœur : "Wa mâ yuttassafu min-al-'aql bihî, yata'allaqu bi hâdhâ wa hâdha" (Majmû' ul-fatâwâ, tome 9 pp. 303-304).
4) L'oreille par laquelle l'homme écoute le message venant du dessus du ciel étoilé :
L'intelligence du cœur, c'est la Lumière que l'homme possède en son intérieur, c'est sa source d'orientation éthique. Mais pour protéger, développer et orienter cette Lumière première, il est une autre Lumière : celle qu'offrent à l'homme les textes de la révélation. Pourquoi le besoin d'une seconde lumière en plus de la première, cliquez ici pour le découvrir à travers un autre article. Ces deux lumières orientent l'homme pour sa spiritualité, pour l'organisation des liens entre lui et ses semblables, pour l'éthique liée aux différents aspects de sa vie.
Le verset que nous avons cité ci-dessus évoque, à côté de la Lumière que l'homme reçoit de son cœur qui raisonne, la Lumière que l'homme reçoit en écoutant le message : "N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'avoir un cœur par lequel ils raisonnent ou des oreilles par lesquelles ils écoutent ?" (Coran 22/46). Le savant Ibn Qayyim a employé ces deux termes : "al-'aql" – raisonner par son cœur – et "as-sam'" – écouter et comprendre le message de la révélation – pour décrire respectivement les aspects des croyances et de l'éthique que l'homme possède de façon quasi-naturelle, et la révélation qui vient protéger, orienter et développer cette perception globale. Ainsi, selon Ibn ul-Qayyim, le fait qu'il doit se produire un jour où les hommes seront justement rétribués pour leurs actes relève, en son essence, de ce que l'intelligence du cœur ressent intuitivement ("al-'aql") ; la façon exacte selon laquelle cette rétribution se déroulera ne peut cependant être comprise qu'en se référant aux textes de la révélation ("as-sam'") (cf. Hâdi-l-arwâh, pp. 499 et 502). Selon ce commentaire, "al-qalb alladhî yu'qal bih" désigne donc bien la Lumière intérieure de l'homme, et "as-sam'" désigne bien la Lumière de la révélation. De la même façon, Ibn Taymiyya emploie de nombreuses fois la formule "ad-dalâ'ïl al-'aqliyya wad-dalâ'ïl as-sam'iyya" : "les preuves provenant de la raison et les preuves provenant de ce qu'on entend", c'est-à-dire de la révélation.
"Il y a là un rappel pour celui qui a un cœur ou qui a prêté l'oreille tout en étant témoin" (Coran 50/37). Si ce verset parle du cœur, il s'agit du cœur qui raisonne – car le terme "qalb" ici employé a été commenté par : "'aql" (cf. Tafsîr Ibn Kathîr) –, donc de l'intelligence du cœur, conformément au verset 22/46.
"Et ils diront : "Si nous avions écouté ou si nous avions raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise"" (Coran 67/10). Ici encore, il est question non pas du raisonnement de la raison pure et froide mais de l'intelligence du cœur (conformément au verset 22/46 et suite aux explications proposées plus haut). Ici encore, écouter concerne le fait d'écouter ce que Dieu a révélé (cf. Tafsîr Ibn Kathîr, commentaire de ce verset).
Les propos de deux philosophes et leur pendant en islam :
Blaise Pascal disait : "Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point". Chaque musulman(e) peut dire : "Le cœur a ses raisons, qui sont différentes de celles de la raison : la raison ne pouvait produire d'elle-même ces raisons du cœur ; en revanche elle peut et doit les connaître, les reconnaître et les prendre en considération."
Le philosophe allemand Kant disait : "Deux choses ne cessent de remplir mon cœur d'admiration et de respect plus ma pensée s'y attache et s'y applique : le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale en moi". Chaque musulman(e) peut quant à lui(elle) dire : "Deux lumières ne cessent de remplir mon cœur d'admiration et de respect plus ma pensée s'y attache et s'y applique : la lumière qui est en moi, qui est celle de mon cœur avec l'accompagnement duquel je raisonne ; et la lumière qui vient d'au-dessus du ciel étoilé au-dessus de ma tête, qui est la lumière de la révélation divine". Dieu dit : "Lumière sur lumière" (Coran 24/35).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
L’âme et le visage du soufisme
04/02/2008 13:49
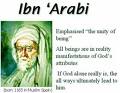
L’âme et le visage du soufisme :
( le sens profond du soufisme et son ancrage dans l’Islam des origines.)
LA MÉDITATION DU CORAN :
Le terme soufisme dérive, selon l’étymologie généralement acceptée, de l’arabe «çuf» ( laine).
Les adeptes avaient en effet l’habitude de se vêtir d’un froc de laine, symbole d’austérité et de détachement du monde. Le surnom « al-sufi » apparaît dès le VIIIe siècle de l’ère chrétienne, un siècle après la mort de Mahomet, et s’applique bientôt à l’ensemble des musulmans s’adonnant aux pratiques ascétiques. Dans un traité ancien de soufisme, nous trouvons cette définition : « Le soufi porte de la laine sur sa pureté, il tyrannise ses désirs et, ayant rejeté le monde, il avance dans la voie du Prophète. »
Les orientalistes ont beaucoup discuté sur l’origine du soufisme. Ils se sont efforcés de déceler des influences étrangères. Tantôt on l’a rattaché au Védanta de l’Inde ; tantôt on a mis l’accent sur des ressemblances avec le zoroastrisme et le néoplatonisme. On l’a aussi considéré comme une réaction contre une religion qui laissait peu de part aux aspects émotionnels de l’expérience spirituelle. On a relevé aussi des affinités existant entre le soufisme et la mystique chrétienne. Quelles que soient les comparaisons qu’on puisse établir avec d’autres formes de pensée religieuse, l’origine islamique du soufisme ne semble cependant pas pouvoir être mise en doute. La lecture, la récitation, la méditation du Coran fournissent au pieux musulman une source constamment renouvelée de vie spirituelle. La beauté même du texte étaye le dogme du caractère miraculeux du livre saint, que nul art humain n’eût pu composer. « Ce qui donne au Coran sa puissance d’émouvoir le cœur des hommes et de modeler leur vie n’est pas son contenu de doctrines et d’exhortations dans sa nudité, mais sa vivante parure verbale. Comme les livres prophétiques de l’Ancien Testament, il parle la langue de la poésie, bien que délié du joug extérieur du mètre et de la rime. Si par poésie on entend la disposition presque magique des mots en sorte qu’ils se répercutent comme des échos dans l’âme, découvrant à l’œil intérieur de grands horizons et créant dans l’esprit une exaltation qui le soulève au-dessus du monde matériel et l’illumine d’un rayonnement soudain, c’est justement ce que signifie le Coran pour le musulman. Le musulman ne trouve dans aucun autre livre sacré cette qualité poétique, cette aptitude à soutenir et à renforcer la faculté de vision intuitive, ce bond par lequel l’âme et l’esprit saisissent, en une expérience concrète, la réalité derrière les phénomènes éphémères du monde matériel ». (A.R. Gibb).
À la magie incantatoire du texte saint, véhicule du message divin, viennent s’ajouter tous les prolongements et les résonances que permet l’arabe, langue liturgique, qui par sa nature même se prête à une herméneutique étagée sur plusieurs plans. C’est ainsi que les soufis parlent de sept ou même de soixante-dix-sept interprétations possibles, de plus en plus intériorisées. Une telle « lecture » sera en définitive fonction de la capacité spirituelle du récitant, comme si le texte lui était révélé à l’instant, en ce lieu, à lui-même.
L’un des plus grands maîtres du soufisme, Jalal-od-Din Rûmi, donne cet exemple de l’interprétation spirituelle des écritures. Après avoir conté que Yahya (Jean-Baptiste) se prosterna en adoration devant le Messie, alors que tous deux se trouvaient encore dans le sein de leurs mères, il note que les ignorants considèrent cette histoire comme fausse et invraisemblable. Mais, dit-il,
« Celui qui connaît le sens caché, et pour qui ce qui est caché dans le monde est présent,
Sait que la mère de Jean-Baptiste peut apparaître à Marie bien qu’elle soit loin de ses yeux.
Les yeux fermés voient l’ami, à condition que l’enveloppe charnelle soit rendue perméable à la lumière.
Mais, alors même qu’elle ne l’aurait vue ni de l’extérieur, ni de l’intérieur, ô toi, esprit faible,
Tâche de comprendre le sens profond de cette histoire, et non pas comme celui qui a entendu des fables et reste attaché à leur sens littéral. »
TOUT EST SIGNE DE DIEU (swt):
Tout est signe pour celui qui sait voir : « Nous savons, dit Ibn’Arabi, maître soufi du xiiie siècle, que Dieu s’est décrit lui-même comme l’Extérieur (al-Zahir) et comme l’Intérieur (al-Batin) et qu’il a manifesté le monde à la fois comme intérieur et extérieur, afin que nous connaissions l’aspect intérieur (de Dieu) par notre propre intériorité et l’extérieur par notre extériorité. Nous leur montrons, dit le Coran, nos signes aux horizons et en eux-mêmes... »
Le livre saint fait constamment appel à cette prise de conscience :
« De quelque côté que tu te tournes, là est la Face de Dieu... En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l’alternance de la nuit et du jour, dans les navires qui parcourent les mers avec ce qui est utile à l’homme, dans la pluie que Dieu fait descendre du ciel pour rendre vie à la terre qui était morte et répandre sur elle toutes sortes d’animaux, dans le changement des vents, dans les nuages qui sont astreints au service entre le ciel et la terre, dans toutes ces choses, il y a des signes pour ceux qui comprennent. » (Coran II/V. 109, 159).
AU CŒUR ÉPRIS D’AMOUR
Mais cette immanence de Dieu(swt) au monde n’est perceptible qu’aux yeux purifiés. Ainsi que le dit Rûmi, le soufi persan : « Si tu bois, assoiffé, de l’eau dans une coupe, c’est Dieu que tu contemples au sein de l’eau. Celui qui n’est pas un amoureux (de Dieu) ne voit dans l’eau que sa propre image. » Seuls les yeux dessillés peuvent découvrir que « l’univers est le livre de la Vérité très haute ». Seul le cœur poli par l’ascèse est susceptible de devenir ce miroir sans tache où se reflétera le divin. Le soufisme a toujours fait une large place aux pratiques de mortification. Ce caractère ascétique est particulièrement marqué au début du mouvement, en réaction contre la décadence religieuse et la corruption des mœurs qu’avait entraînées, au Ie siècle de l’Islam, l’extraordinaire extension des conquêtes.
Une pieuse femme de Basra, Rabi’a (morte en 801) s’adressait ainsi à Dieu :
« Je t’aime de deux amours : amour visant mon propre bonheur et amour vraiment digne de Toi. Quant à cet amour de mon bonheur, c’est que je m’occupe à ne penser qu’à Toi et à nul autre. Et quant à cet amour digne de Toi, c’est que Tes voiles tombent et que je Te vois. Nulle gloire pour moi, ni en l’un ni en l’autre, mais gloire à Toi pour celui-ci et pour celui-là. »
En témoignant de l’unité divine par la profession de foi, le croyant atteste que la divinité seule est digne d’adoration.
Tel sainte Thérèse d’Avila, « mourant de ne pas mourir », le poète soufi du IXe siècle Dhu’l-Nûn (l’Égyptien )chante la nostalgie de l’union divine :
« Je meurs, sans que pourtant meure en moi L’ardeur de mon amour pour Toi,
Et Ton amour, mon unique but,
N’a pas apaisé la fièvre de mon âme.
Vers Toi seul mon esprit jette son cri ;
En Toi repose toute mon ambition.»
VERS L’UNION MYSTIQUE :
Dieu(swt) est la seule réalité, le seul but de la quête incessante de l’âme, peu importe la voie qui mène à lui. Les soufis se sont toujours faits les apôtres de la plus large tolérance : « Il y a, dit Jalal-od-Din Rûmi, bien des chemins de recherche, mais l’objet de la recherche est toujours le même. Ne vois-tu pas que les chemins qui conduisent à La Mecque sont divers, l’un venant de Byzance, l’autre de Syrie et d’autres encore passant par la terre ou la mer ? La distance de ces chemins à parcourir est chaque fois différente mais, lorsqu’ils aboutissent, les controverses, les discussions et les divergences de vues disparaissent, car les cœurs s’unissent... Cet élan du coeur n’est ni la foi, ni l’infidélité, mais l’amour. »
Pour le soufisme, l’amour est en vérité l’âme de l’univers. C’est grâce à lui que l’homme tend à retourner à la source de son être. La musique et la danse, la giration des étoiles et le mouvement des atomes, l’ascension de la vie sur l’échelle de l’être, de la pierre à la plante, de l’animal à l’homme, jusqu’à l’ange et au delà — tout est dû à l’amour qui est « l’astrolabe pat lequel se révèlent les mystères cachés ».
L’âme éloignée de son ultime réalité tend à la rencontre qui lui révélera que l’amant et l’aimé ne sont qu’un. Un jour, est-il raconté dans l’une des paraboles du Mathnavi’ ; un homme vint frapper a la porte de son ami. « Qui es-tu ? » lui demande celui-ci. Il répond : « C’est moi » — « Va-t’en, je ne te connais pas. » Après un an d’absence, brûlé d’amour et de chagrin, le pauvre homme s’en revient frapper à la porte. « Qui es-tu ? » lui redemande l’ami. Et cette fois, il répond : « Je suis toi ! »
— «Entre alors !», lui dit l’ami,« puisque tu es moi : il n’y a pas de place ici pour deux « moi ». »
Le but du soufi, comme de tout mystique, sera de mourir à lui-même pour vivre en Dieu(st), retrouvant ainsi la source de son être. « Toute chose est périssante, hormis la Face de Dieu », dit le Coran. Le maître de Balkh, Jalal-od-Din Rûmi attendait avec impatience la suprême rencontre avec le Bien-Aimé. Il déclarait : « En vérité, ma mort seule est ma vie. »
La mort, pour les mystiques, c’est la vue de la Vérité Suprême !
Comment fuiraient-ils devant cette vue ? Lors de sa dernière maladie, à un ami qui lui souhaitait de recouvrer la santé, Rûmi répondit : « Entre l’amant et l’amante, il ne reste plus qu’une chemise de crin. Ne voulez-vous pas qu’on la retire et que la lumière se joigne à la lumière ? »
Toutefois, si la mort terrestre déchire les derniers voiles, Jalal-od-Din Rûmi rappelle à chaque instant que le royaume de Dieu est au dedans de nous : « On peut voir le Créateur dans chaque objet créé, on peut contempler le soleil des vérités dans chaque atome. »
LES CONFRÉRIES :
Tel est le climat de la spiritualité soufie : Dieu(swt) sensible au cœur — en entendant justement ce terme (qalb, en arabe, dil, en persan) au sens pascalien d’intuition, de « fine pointe » de l’âme. Dieu(swt) est recherché ardemment tout au long d’un pèlerinage mystique jalonné d’étapes, qui sont elles-mêmes « colorées » par une certaine tonalité, ou disposition intérieure. Dans la pratique, l’appartenance au soufisme, en dehors de cas isolés, se traduit par l’appartenance à différentes « voies » (tariqa) : « Chaque grand maître à partir duquel on distingue une chaîne initiatique particulière a autorité pour adapter la méthode aux aptitudes d’une certaine catégorie d’hommes doués pour la vie spirituelle. Les diverses voies correspondent donc aux diverses vocations et sont toutes orientées vers le même but. » (Titus Burckhardt)
Le terme arabe de tariqa, signitiant chemin, route, voie, a pris deux acceptions techniques successives en mystique musulmane. Dans la première, selon Louis Massignon, il désigne une méthode de psychologie morale pour guider chaque vocation individuelle, en traçant diverses étapes de la pratique littérale de la loi révélée jusqu’à la Réalité divine. Il en est ainsi aux IXe et Xe siècles de notre ère, et les noms des grands soufis Jonayd, Hallâj, Sarraj, Kushairi, Hudjwiri sont des maîtres en mystique. Dans sa seconde acception, le terme de tariqa désigne, à partir du XIe siècle, l’ensemble des rites d’entraînement spirituel préconisés dans les diverses congrégations musulmanes qui commencent dès lors à se fonder. Par extension, il est devenu synonyme de confrérie, il désigne une vie commune fondée sur des prescriptions spéciales, sous l’autorité d’un maître commun. L’appartenance à une de ces confréries peut entraîner la résidence dans un monastère, généralement pour des périodes plus ou moins longues, très rarement pour toute la vie, la plupart des adhérents étant mariés. Des centaines de confréries furent fondées ; plusieurs d’entre elles comptent encore aujourd’hui des adhérents par milliers. Chacun d’eux est en principe astreint à suivre certaines règles de méditation, de prières, etc., et assiste aux réunions périodiques de sa tariqa.
LE ROLE DU MAITRE :
Les traités de soufisme décrivent minutieusement la règle à suivre dans chaque couvent. Le rôle du maître (pir, en persan ; murshid, en arabe) qui le dirige et à qui est due une obéissance absolue, consiste à adapter les exercices aux besoins spirituels et aux capacités des disciples ou murid. Mais les liens entre maître et disciple soufis sont bien plus étroits que ceux qui peuvent attacher à un « directeur de conscience » au sens ordinaire de ce terme. Il ne s’agit pas seulement de l’enseignement d’une méthode conformément aux aptitudes d’hommes aspirant à une vie spirituelle, mais d’une transmission initiatique, de la communication d’une influence spirituelle, d’un influx divin (baraka) que peut seul conférer un représentant d’une « chaîne » (silsila) remontant au Prophète(saw) lui-même. Pratiquement, cette initiation est symbolisée par l’investiture, la remise par le maître au disciple de la khirqa, le froc de bure. Pour qu’il puisse valablement le faire, il faut que le maître soit lui-même digne d’imitation, c’est-à-dire qu’il doit connaître parfaitement, tant au point de vue théorique que pratique, les trois phases de la vie mystique — La Loi, la Voie et la Vérité. Il lui faut être entièrement délivré de ses appétits charnels, de sorte que rien de son moi inférieur ne demeure en lui. Quand un tel shaikh est parfaitement au courant des actes et des pensées d’un disciple, et sait qu’il est digne de progresser dans la Voie, il pose la main sur sa tête et le revêt de la khirqa, témoignant ainsi qu’il mérite de s’associer aux soufis. Lorsqu’un derviche inconnu vient dans un monastère ou une association de soufis, on lui demande : « Quel est le maître qui t’a instruit ? » et « De quelles mains as-tu reçu la khirqa ? »
Le murid est ainsi dit fils du shaikh. Cette notion de maître et disciple répond à la structure même de l’Être, il y a dédoublement du Seigneur et du Vassal qui aspirent l’un vers l’autre. « Le shaikh est ton Créateur », dit Ibn’Arabi. Comme l’écrivait Barrès, une congrégation « enregistre et transmet à travers les siècles le fluide particulier de son fondateur ». En outre, comme le note le professeur Nicholson, chaque murid a ses amis, et toute la communauté soufie constitue une fraternité indivisible, de sorte que le moindre adepte se sent uni spirituellement au hiérophante le plus exalté. Les soufis se regardent comme le peuple choisi de Dieu ; ils se sentent aimés par Lui, et s’aiment les uns les autres en Lui. Le lien entre eux ne peut jamais être brisé, car c’est un mariage d’âmes qui a été conclu au ciel.
L’APOLOGUE DES TROIS PRINCES :
L’enseignement des maîtres tend à faire accéder le disciple à une connaissance mystique ( marifat ) qui constituera la seconde naissance, la naissance spirituelle. Cette maïeutique a très souvent recours à des apologues, susceptibles d’interprétations de plus en plus profondes, qui ne s’excluent pas les unes les autres, mais se com¬plètent. Ici encore, il s’agit de déchiffrer des symboles valables sur plusieurs registres. Voici par exemple, une parabole due au maître des derviches tourneurs, Jalal-od-Din Rûmi, dont nous avons déjà parlé.
C’est l’histoire des trois princes et de la citadelle merveilleuse. Il y avait, est-il raconté dans le Mathnavi, trois frères. Le roi, leur père, possédait sur son territoire une forteresse dans laquelle il était absolument interdit de se rendre. Les trois princes, sachant que c’était interdit, avaient d’autant plus envie d’y aller. Lorsqu’ils y furent parvenus, ils virent que cette citadelle avait dix portes. Une fois celles-ci franchies, ils découvrirent de magnifiques peintures qui les remplirent d’émerveillement, et notamment le portrait d’une jeune fille dont la beauté les éblouit et les enflamma d’amour. S’étant informés, ils apprirent qu’il s’agissait de la princesse de Chine, gardée recluse dans une tour par son père l’empereur. Ils décidèrent aussitôt de partir pour la Chine. Après avoir attendu longtemps dans la capitale, l’un des princes, à bout de patience, vint se jeter aux pieds de l’empereur. Celui-ci le traita avec tendresse et le jeune homme devint de plus en plus enivré d’amour. Le jeune prince finit par en mourir. Le frère cadet étant malade, le second frère assista seul aux funérailles. L’empereur lui témoigna la même bienveillance, et le combla de dons. Peu à peu, ce prince en conçut de l’orgueil et donna des preuves d’ingratitude. L’empereur en fut indigné et, sans le vouloir, lui infligea une blessure mortelle. Le troisième frère était le plus paresseux de tous. Il ne fit rien, et pourtant ce fut lui seul qui réussit à atteindre le but ; l’histoire ne nous dit pas comment. Jalal-od-Din Rûmi a repris ici un thème folklorique très connu. Ce qui est important, c’est moins l’anecdote que le commentaire donné par le sage soufi. Il explique tout d’abord que c’est l’attrait des choses défendues qui incite à leur recherche ; l’itinéraire spirituel aussi est une aventure. Les princes se sont lancés sans guide dans leur quête ; c’est fort dangereux. Les dix portes de la citadelle représentent les cinq sens externes et les cinq sens spirituels. Les peintures sont les formes et les couleurs du monde par lesquelles l’âme risque d’être ensorcelée et détournée de sa véritable voie. Traditionnellement, la Chine désigne dans le soufisme le domaine spirituel, alors que l’Égypte est le domaine matériel. Quant aux trois princes, le premier est mort d’amour ; le second initié aux mystères par le roi, est perdu par sa présomption. La pointe de l’apologue est ici : pourquoi le troisième prince a-t-il remporté une victoire complète, alors qu’il était le plus paresseux ?
Ce que Rûmi appelle ici paresse, on pourrait à meilleur escient l’appeler passivité. Il y a quelque chose d’infiniment passif, d’absolument abandonné, dans l’âme du mystique qui appelle la grâce, ce don de Dieu, et c’est là une sorte de virginité, d’offrande de soi, comparable à l’atti¬tude de Marie devant l’ange de l’Annonciation.
Ainsi que le dit le commentaire d’Ismaël d’Ankara : « Lorsque la parole de Dieu pénètre dans le cœur de quelqu’un et que l’inspiration divine emplit son cœur et son âme, sa nature est telle qu’alors est produit en lui un enfant spirituel ayant le souffle de Jésus qui ressuscite les morts. » Si le petit prince paresseux parvient seul à remporter la victoire, c’est qu’il n’a pas compté sur ses propres efforts : il est resté « passif » et disponible à la grâce divine qui a pu le saisir.
L’APOLOGUE DES CHINOIS ET DES BYZANTINS :
Dans une autre parabole Jalal-od-Din Rumi compare la démarche vers Dieu (swt)des étudiants en théologie avec celle des mystiques soufis. Un jour, raconte-t-il, un sultan appelle à son palais des peintres, venus les uns de la Chine, les autres de Byzance, et les charge de décorer de fresques deux murs qui se faisaient face. Un rideau fut tiré entre les deux groupes de concurrents qui travaillaient donc sans apercevoir ce que faisaient leurs rivaux. Or, tandis que les Chinois employaient toutes sortes de peintures et dessinaient de ravissantes figures, les Grecs se contentaient de polir le mur et de le lisser sans relâche. Le jour venu, le sultan vint juger des résultats de cette compétition. Il se dirigea tout d’abord du côté du rideau où se trouvaient les peintres de Chine, et tomba en extase devant la beauté de leur fresque. Il déclara que l’on ne pouvait, en vérité, rien concevoir de plus beau. Mais lorsque le rideau fut tiré, les peintures des Chinois se reflétèrent dans le mur qu’avaient poli les peintres de Byzance à la façon d’un miroir — et ce reflet était bien plus beau que l’œuvre d’art elle-même. On pourrait imaginer que le reflet fût aussi beau que l’image : mais pourquoi la surpasse-t-il ? Il y a là, tout d’abord, une raison d’esthétique. Rûmi parle ailleurs de l’amour du beau, plus beau que la beauté elle-même. Mais il s’agit ici d’une sorte de pressentiment. La vérité n’est pas quelque chose de tout fait, c’est quelque chose vers quoi on se dirige, guidé par l’intuition, de même qu’un parfum fait deviner une réalité cachée. Rien, sur le plan spirituel, n’est achevé. Selon une telle conception, les couleurs représentent ce que le monde phénoménal (les apparences) comporte d’impureté : le monde nouménal (les réalités) est « sans couleur », disent les soufis persans.
De même, Shelley parlait de la vie comme d’un verre bigarré « qui souille la pure blancheur de l’éternité ». Le monde phénoménal sert en quelque sorte de prisme au monde de l’intelligible. Les soufis « comparent l’univers à un ensemble de miroirs dans lesquels l’Essence infinie se contemple sous de multiples formes, ou qui reflètent à divers degrés l’irradiation de l’Être unique ; les miroirs symbolisent les possibilités qu’a l’Essence de se déterminer Elle-même, possibilités qu’Elle comporte souverainement en vertu de Son infinité » (Burckhardt).
Le cœur du mystique, poli par l’ascèse, débarrassé du péché et des imaginations vaines, devient cette paroi blanche comme la neige où se reflétera la beauté divine.
Le soufisme, d’une façon générale, met l’accent sur l’aspect « beauté » de la Réalité ultime. Selon Ibn’Arabi, Dieu(swt) aime la beauté des formes parce que la forme reflète la beauté de Dieu(swt), comme elle reflète l’Être. Une tradition prophétique dit : « Dieu est beau et Il aime ce qui est beauté ! » La beauté apparaît ici comme la raison suffisante de l’amour. À travers ces apologues, on aperçoit toute la subtilité de la doctrine des soufis.
Qu'Allâh(swt) nous accorde une agréable et longue ,vie enveloppée d'une bonne santé de fer, dans son obéissance et dans son adoration sincère ! Qu'il(swt) nous ouvre les portes de la connaissance spirituelle et matérielle pour l'Amour de Mawlana Muhammad(saw) !
Wa salam
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Husayn Mansur Hallaj,le poète Mystique de tous les temps !
02/02/2008 21:21

HALLÂJ POÈTE
Hallâj est connu comme un grand mystique, sans doute le plus grand des mystiques musulmans et un des grands mystiques de tous les temps. Il fut aussi un poète. Louis Massignon, qui l'a fait connaître en Occident et qui lui a consacré les quatre volumes de son oeuvre maîtresse, La Passion d’al-Hallâj, admirait et a fait connaître aussi l'originalité de son oeuvre littéraire (Passion III, 352-373). Plus récemment, Sami-Ali a publié chez Sindbad (1985) une traduction des Poèmes mystiques de Hallâj avec une remarquable introduction sur La poétique de Hallâj, édition de poche chez Albin Michel (1998). Nous nous proposons d'examiner en quoi et comment Hallâj est-il poète? Qu'est-ce qui fait l'essence de la poésie chez Hallâj? Quels sont ses procédés poétiques? Avant de répondre à ces questions, il convient de rappeler brièvement quelle fut la personnalité de Hallâj.
Husayn Mansour Hallâj est né en 244 de l'ère musulmane (857) à Beïza, centre très arabisé dans la province perse d'Ahwâz. Son père était cardeur. Son premier maître en mystique fut Sahl de Tustar, puis, à vingt ans, il reçut du grand maître 'Amr Makki, l'habit monastique de sûfi à Basra. Il se maria dans le même temps et eut quatre enfants. Sa belle famille avait des accointances shî'ites extrémistes (zanj) qui le firent suspecter, bien qu'il fût rigoureusement sunnite. Après un premier hajj d'un an à la Mecque, il commença sa première prédication publique en Ahwâz, en rejetant l'habit sûfi, puis il poursuivit sa prédication en Khurâsân. Au bout de cinq ans, il vint s'installer avec sa famille à Bagdad. Après un second pèlerinage, il repartit pour un second grand voyage jusqu'à l'Indus et en revint pour son troisième et dernier pèlerinage (vers l'an 290/902). Revenu à Bagdad, il commença à tenir en public des discours surprenants qui provoqueront une grande émotion populaire. Il fut dénoncé par le poète sunnite zahirite Ibn Dawud, qui demanda sa condamnation à mort. D'abord acquitté, Il fut ensuite à nouveau menacé par le vizir shî'ite Ibn al Fûrat. Quatre disciples sont arrêtés mais lui-même s'échappe et se cache à Suse en Ahwâz, où il sera arrêté et ramené à Bagdad. Son interminable procès de neuf ans, soumis aux retournements du pouvoir, commence alors. En 301/913, un nouveau vizir, prohallagien, Ibn Isâ, fait avorter le procès et soustrait le cas de Hallâj à la compétence du cadi. Hallâj est interné au Palais mais il est autorisé à prêcher aux détenus et il est introduit auprès du khalife. Mais en 306/919, le vizir Hâmad fait rouvrir son procès. Tirant argument de la doctrine de Hallâj sur le remplacement votif du hajj, le cadi prononce la formule : "il est licite de verser ton sang", approuvé par 24 membres du tribunal canoniste. Deux jours après, le 27 mars 922 (309), Hallâj est exhibé au gibet et le lendemain intercis et décapité. Son tronc fut incinéré et ses cendres jetées dans le Tigre. La tête fut gardée par la Reine-mère - qui lui était favorable - au "trésor des têtes" du Palais, avant d'être envoyée en Khurâsân. C'était le premier martyre d'un mystique en Islam.
Ses oeuvres - le peu qu'il en reste -, c'est-à-dire les poèmes et oraisons extatiques (Diwân), les sentences détachées (Riwâyât), les oraisons (munâjât) parvenues sous la forme de Akhbar al Hallâj, les fragments dogmatiques des Tawâsin (dont l'opuscule dit Tâ Sîn al-Azal sur Iblis (Satan), écrit et publié en prison), ont été sauvées par ses disciples et retransmises selon la coutume musulmane par des chaînes (isnad) de "rapporteurs". Ses poèmes proprement dits, tirés pour la plupart des Akhbar al Hallâj où le récit en prose rimée précède le récitatif en vers - le Tâ Sîn al-Azal est de même un mélange de prose et de vers - ont été réunis pour la première fois en traduction française par Louis Massignon dans le Diwân (première édition en 1931). L'édition de Sami-Ali ne retient pas 39 poèmes sur 88 considérés comme non authentiques. Il est vrai que Hallâj, comme Louis Massignon l'a noté, récitait volontiers à ses auditeurs des poèmes d'autres auteurs mystiques, voire empruntés à l'amour profane, particulièrement des poèmes d'Abu Nuwas.
En Hallâj, poète et mystique se confondent. C'est parce qu'il est mystique qu'il est poète. Car poésie et mystique ont en commun d'atteindre l'ineffable. La thèse de l'abbé Brémond assimilant prière et poésie a été très contestée. Mais lorsqu'on est affronté aux shatahât (pluriel de shath) de Hallâj, c'est-à-dire à ses "locutions théopatiques", autrement dit à ses oraisons extatiques, par lesquelles il exprime sa rencontre avec l'Unique, l'assimilation devient tangible. Selon la formule frappante de Sami-Ali, l'oeuvre de Hallâj "porte à sa plus haute expression l'impossibilité d'affirmer l'Unique sans se nier et de s'affirmer sans nier l'Unique". Le problème qui se pose au mystique, à tout mystique, chrétien comme musulman, lorsqu'il veut traduire en termes discussifs ses états ou son extase, lorsqu'il procède à une rétrospection pour les expliquer et les commenter, a été étudié à plusieurs reprises par Louis Massignon, notamment dans Introspection et rétrospection. Le sentiment littéraire des poètes et l'inspiration proprement mystique comment ils s'explicitent et comment les différencier (en poésie islamique)" (Opera Minora, II, pp. 355-365) et dans L'expérience mystique et les modes de stylisation littéraire (O.M. II, 371-387). Louis Massignon, qui pense principalement à Hallâj et aux mystiques des trois premiers siècles de l'Islam étudiés par lui dans son Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, montre comment "le mystique essaie de nous faire retrouver la commotion initiale que son coeur a enregistrée" et où il croit trouver "une intervention de l'être transcendant (…) allant jusqu'au "déplacement" de la consciences (c'est à proprement parler le shath, qui est un "débordement" de la conscience). Ce "déplacement" transfère notre attention vers Dieu "par un mouvement anagogique qui nous libère du créé". "Le gauchissement concerté de la phrase (c'est-à-dire des termes usuels) amincit alors progressivement la personnalité de son sujet provisoire". "A la limite extrême (...) l'objet transcendant et unique, le seul Réel, Dieu, s'affirme brusquement au lecteur comme prochainement concevable, comme l'intelligible par excellence; tandis que simultanément, le "je " humain du sujet normal de la phrase s'esquive devant un autre "je" divin, qui se démasque" (O.M. II, 364-5).
C'est proprement la démarche de Hallâj, telle qu'il l'a rendue dans les Akhbar al-Hallâj (n° 50), dans des locutions théopathiques célèbres: " Entre moi et toi, il y a un "c'est moi" qui me tourmente Ah! enlève par ton "c'est moi" (Sami-Ali traduit "je suis") mon "c'est moi" hors d'entre nous deux". Louis Massignon raconte lui-même que c'est en travaillant sur Hallâj (O.M. II, pp. 371-2) qu'il a pressenti que les textes mystiques authentiques peuvent "faire accéder au Réel", car le langage "recèle un sens anagogique", un harpon destiné à tirer l'âme à Dieu". Il remarque alors que l'intensité d'accent de ces auteurs "paraissait issue d'une commotion initiale suprasensible" et que "certaines sentences plus outrancières (les shatahât) "essayaient de saisir et de situer, non sans rétrospection, la commotion même de la touche divine, (…) d'enregistrer l'échange du "je" humain et du "je" divin". Et il donnait comme exemple de shath ce verset de Hallâj : "T'invoquerais-je: c'est "Toi", si Tu ne m'avais pas appelé "C'est Moi"?
C'est cette relation à l'Unique qui fait Hallâj poète... jusqu'à la mort, jusqu'au martyre, comme l'a dit Hallâj lui-même au moment de son supplice: " Ce qui compte pour l'extatique, c'est que l'Unique le réduise à l'unité". Un martyre qu'il avait appelé de ses voeux et annoncé: "Tuez-moi donc, mes féaux camarades, c'est dans mon meurtre qu'est ma Vie!" (qâsida X) et encore : "Oui, va-t-en prévenir mes amis que je me suis embarqué pour la haute mer et que ma barque se brise! C'est dans l'instance suprême de la Croix que je mourrai..." (muqatta’a 56). Ou encore, de façon terrifiante, Hallâj se voit dévoré par le négatif de Dieu, Satan, sous la forme du Dragon - signe astrologique: "Puis, quand la coupe circula, Il fit apporter la peau du supplice et le glaive / Ainsi advient-il de qui s'enivre avec le Dragon, l'été". (muqatta’a 37, traduction Sami-Ali).
Le thème de l'Union divine est le plus récurrent, sinon l'unique, dans les poèmes de Hallâj, soit qu'il traite de la connaissance illuminative, de façon didactique, soit directement de l'Union mystique, de l'extase. Laissons parler Hallâj (les traductions sont celles du Diwân publié par Massignon, sauf exceptionnellement celles de Samî-Ali, plus concises) :
"Nous sommes deux esprits infondus en un (seul) corps / Aussi me voir c'est Le voir et Le voir c'est nous voir" (Tawâsin)
"Ton image est dans mon oeil, ton invocation dans ma bouche. / Tu demeures dans mon coeur. Où donc peux-tu être absent? (Yatîma I, traduction Sami-Ali).
"Avec l'oeil du coeur, je vis mon Seigneur. / Et Lui dis: qui es Tu? Il me dit: Toi" (muqatta’a 10)
"Et maintenant je suis Toi-même, / Ton existence c'est la mienne et c'est aussi mon vouloir" (muqatta’a 15)
"Tu demeures dans mon coeur et il contient le mystère de Toi. / Que la demeure se réjouisse et que se réjouisse le voisin! / Il ne contient aucun mystère que je connaisse sauf Toi / Regarde avec Ton oeil: y a-t-il un autre dans la demeure? / Que la nuit de la séparation s'allonge ou s'écourte / L'espoir et le souvenir de Lui me tiennent compagnie. / Ma perte me convient qui Te convient, ô mon Tueur / Et je choisis ce que Tu choisis" (muqatta’a, 23, traduction Sami-Ali).
"J'ai étreint, de tout mon être, tout Ton amour, ô ma Sainteté! / Tu me mets à nu, tant, que je sens que c'est Toi en moi..." (muqatta’a 30)
"Son esprit est mon esprit et mon esprit Son esprit; / Qu'Il veuille, et je veux; que je veuille, Il veut" (muqatta’a 32).
"Ton esprit s'est emmêlé à mon esprit / Tout ainsi que s'allie le vin avec l'eau pure / Aussi qu'une chose Te touche, elle me touche! / Ainsi donc Toi c'est moi, en tout!" (muqatta’a 47)
Et le verset le plus célèbre: "Unifie moi, ô mon Unique (en Toi) / En me faisant vraiment confesser que Dieu est Un / Par un acte où aucun chemin ne serve de route! / Je suis vérité en puissance, et comme la Vérité en acte (al Haqq) est son propre potentiel, / Que notre séparation ne soit plus!... (muqatta’a 39)
On sait que Louis Massignon répugnait à qualifier de mystique authentique tout ce qui pouvait avoir un relent de panthéisme, de monisme existentiel, comme il disait. Dans la Passion (III, pp. 49-60,) il récuse l'accusation de hulul (fusion) qu'on a portée contre Hallâj lorsqu'il parlait d'union transformante pour montrer, à partir des textes hallagiens que chez Hallâj cette union ne pouvait qu'être une "identification intermittente" du sujet et de l'objet et qu'il s'agissait de ce qu'il appelait un "monisme testimonial" : le mystique est un témoin, un shahid, qui témoigne de Dieu (shahid a en arabe le double sens de témoin et de martyr). Et dans l'Essai (p.314) : "L'identification intermittente du sujet et de l'objet (...) ne se renouvelle que par une transposition incessante, et amoureuse des rôles, entre eux deux, par une alternance vitale comme l'oscillation la pulsation, la sensation, la conscience; se surimposant de façon surhumaine et transcendante, sans jamais se stabiliser normalement ni de façon permanente, pour le coeur d'un sujet humain donné, en cette vie mortelle". Pour Hallâj, l'union transformante se réalisait "par une sorte de transposition soudaine des rôles entre Dieu et l'homme, d'échange entre la langue et le coeur du mystique; où tantôt c'est encore Dieu qui inspire le coeur et l'homme qui rend témoignage par sa langue, - et tantôt l'homme qui aspire en son coeur, et Dieu qui rend témoignage par sa langue, l'accord demeure parfait et constant entre les deux "moi et toi" (Passion, III, pp. 47-48). "Le résultat de l'acceptation permanente (par le mystique) du fiat divin est la venue dans l'âme du mystique, de l'Esprit divin, lequel "provient du commandement de mon Seigneur" et fait désormais de chacun des actes de cet homme, des actes véritablement divins; et qui en particulier donnera aux paroles de son coeur, l'articulation, l'énonciation et l'application voulues de Dieu" (Passion, III, p. 52). Dans cette Unité se déploie la dialectique du caché et du dévoilé, de la négation et de l'affirmation, du manifeste et du latent. Toute distance est supprimée, mais pour un court instant : "Nul éloignement pour moi après Ton éloignement, depuis que j'eus la certitude que proche et loin sont un" (muqatta’a, 13). Hallâj disait encore: "Est-ce Toi? Est-ce moi? Cela ferait une autre Essence au-dedans de l'Essence. Loin de Toi, loin de Toi (le dessein) d'affirmer "deux". Il y a une Ipséité tienne (qui vit) en mon néant désormais pour toujours, / C'est le Tout qui brille par devant toute chose, équivoque au double visage" (Akhbar n°50, muqatta’a 55).
Tous ces textes expliquent, amènent le fameux "Ana al haqq" de Hallâj (je suis la Vérité, je suis Dieu) qui avait tellement choqué les théologiens musulmans et lui a, au fond, valu sa condamnation à mort. En fait, commente Massignon, Hallâj "constate en lui-même, avec encore plus de force, a posteriori, qu'il y a un degré suprême de la présence divine en ses créatures qui peut se réaliser et se consommer dans l'homme, sans division ni confusion. Il déclare que le mode d'opération de cette union mystique est transcendant, au-dessus du créé et de tout ce dont l'homme est digne: un don gratuit de l'Incréé, ihsân, au-dessus de toute rétribution créée" (Passion, III, p.58). La poésie de Hallâj est, ainsi, à la fois, en même temps, poésie pure et pensée didactique. Deux poèmes, qu'il faut citer longuement, montrent particulièrement comment la poésie, d'un même mouvement, atteint l'être et décrit, pense, les voies d'accès à l'Être. La saisie de l'Être ne peut qu'être instantanée, mais, en la pensant, le poème la décompose: "Les états d'extase divine, c'est Dieu qui les provoque tout entiers, quoique la sagacité des maîtres défaille à les comprendre. L'extase, c'est une incitation, puis un regard (de Dieu) qui croit et flambe dans les consciences; lorsque Dieu, ainsi, vient habiter la conscience, celle-ci, doublant d'acuité, permet alors au voyant d'y observer trois phases: celle où la conscience est encore extérieure à l'essence de l'extase; celle où elle devient spectatrice étonnée; celle où la ligature du sommet de la conscience s'opère; et alors elle se tourne vers une Face dont le regard la ravit à tout autre spectacle". (muqatta’a 19, Diwân, p.77). Et dans l'étonnante Qâsida 7, qui fait appel précisément à "l'oeil du savoir" : "Avec l'oeil du savoir mon regard indiqua ... Et je fendis le tumulte de la mer de ma pensée / La traversant comme une flèche / Et mon coeur s’envola... vers Celui que, me questionne-t-on sur Lui, / J'indique par un symbole mais que je ne nomme pas jusqu'à ce que ayant dépassé toute limite, / Errant dans les déserts de la proximité je regardai des points d'eau / Et je n'y vis rien qui dépassât les limites de mon image / Alors docile, je vins à Lui / Et dans la proximité, la vision de moi s'absenta de moi / Tant que j'oubliai mon nom." (traduction de Sami-Ali).
Maître Eckhart ou St Jean de la Croix disaient-ils autre chose? La pensée, la poésie de Hallâj ne cesse de tourner autour de l'abolition de la distance entre le Témoin et le Témoigné, entre l'Amant et l'Ami. Elle montre ce qui est caché, ce qui se cache, l'indicible, l'ineffable; par elle le dedans et le dehors coïncident. Dans sa muqatta’a 11 (traduction de Sami-Ali), Hallâj réussit ce tout de force de rendre les moyens de cette incommunicabilité: "J'ai un Bien-Aimé que je visite dans les solitudes / Présent et absent aux regards / Tu ne vois pas L'écouter avec l'ouïe pour comprendre ce qu'il dit... Les figures des qualitatifs ne peuvent Le contenir / Il est plus près que la conscience pour l'imagination/ Et plus caché que les pensées évidentes". Qui a mieux défini la via negativa? Et encore, dans la muqatta’a 54: "La lumière de Ton visage reste un mystère quand on l'aperçoit... Écoute donc mon récit, Bien-Aimé, puisque ni la Tablette ni le Calame ne le sauraient comprendre". Hallâj réussit à rendre l'abstraction pure, la pensée pure. Être et connaissance de l'Être coïncident. "Je suis le Vrai et le Vrai est vrai par le Vrai" (traduction Sami-Ali du dernier vers de la muq. 39.)
La forme chez Hallâj, au service de cette poésie pure, est conventionnelle et obéit aux critères du temps. Elle était celle de ses maîtres, Junayd, Bistami, Muhasibi etc., comme Louis Massignon l'a bien montré dans son Essai. La caractéristique principale d'Hallâj est d'associer la prose rimée (sâj) et la versification. L'introduction explicative est en prose rimée qui prépare, comme un "tremplin", dit Massignon, entraîne le récitatif en vers. Toute sa dernière prédication publique suit cette cadence. Louis Massignon fait remarquer (Passion, III, p. 354) que Hallâj emploie un procédé à rebours des épopées populaires arabes et des poètes de l'amour platonique, comme Ibn Dawud, "chez qui la paraphrase explicative en prose succède aux vers". Louis Massignon distingue, dans le Diwân, les qâsida, qui sont les poèmes proprement dits, de plus de sept vers, les muqatta’a qui sont des "morceaux" de facture plus libre (de trois à sept vers) et les yatîma qui sont des vers isolés sous forme de plaintes. Hallâj utilise souvent un "quatrain" où les premier, second et quatrième hémistiches riment ensemble, a.a.b.a. (son disciple Abil Khayr l'adoptera en persan). Dans les qâsida la rime est la même tout le long du poème. Les rimes préférées de Hallâj sont en râ (l8), nûn (16), mîm et bâ (8). Des nombreux mètres que comporte la métrique arabe, Hallâj utilise surtout le basit (29+5) et le tawîl (16) qui sont les mètres de la qâsida. Ce sont des mètres ascendants, de pieds inégaux. Mais il recourt aussi au wâfir (6) et au ramal (6) qui ont des rythmes plus variables, ou encore au khafif et au kâmil. Il serait fastidieux d'entrer dans les détails de la métrique arabe. Il convient plutôt de noter quelques uns des procédés stylistiques auxquels recourt Hallâj dans ses poèmes: l'allitération, l'allusion et l'emploi des addad (mots à double sens contraire).
Ces procédés stylistiques, communs à la poésie courtoise arabe, ont ceci de propre qu'ils sont intraduisibles et que la meilleure des traductions, de ce fait, passe à côté de la beauté de la forme, exceptionnelle chez Hallâj, même si les arabes puristes lui ont reproché des licences. L'allitération, fréquente, n'est pas par plaisir de la jonglerie. Louis Massignon y voit au contraire, un double dessein: "montrer que l'idée ne "colle" pas forcément au mot qui la traduit " (c'est notamment le problème des synonymes sur lequel achoppèrent les mutazilites) et "indiquer, par une assonance commune, la secrète affinité qui peut unir les sens respectifs de deux mots différents devant la pensée" (Passion, III, 355). Massignon fait aussi observer que "ce cliquetis d'allitérations" apparaît le plus fréquemment "au sortir de syllogismes serrés". Margoliouth y voyait, dit-il, "un parti pris musical, cherchant à atteindre l'émotion plutôt que la raison". Lui, pense plutôt que Hallâj cherchait à "relâcher l'attention pour que la méditation intérieure commence". Exemple de ce cliquetis: le poème célèbre "Tuez moi donc, mes féaux camarades" (cf. supra) se termine ainsi: "Ma mère enfanta son père (allusion à Fatima, "mère de son père"), voilà bien une merveille mienne et mes filles, que j'avais engendrées, sont devenues mes soeurs / Non du fait du temps ni du fait des adultères", où les mots "mère", "père", "soeur", "engendrées", cliquetèrent entre eux comme les termes de parenté. Le cas de l'allusion est plus spécifique à Hallâj. Elle découle du fait même que le sujet - ou l'objet - de la poésie: Dieu, l'Unique, ne peut être atteint que par allusion. L'allusion est nécessaire, d'abord, parce que ce Secret auquel accède le poète ne doit pas être dévoilé: il s'agit d'échapper, tout en la respectant, à la discipline de l'arcane. L'on sait que Hallâj, avec son "Ana al Haqq" fut accusé d'avoir "trahi". Son ami Shibli l'interpella pour cela et Hallâj s'en expliqua avec son célèbre poème "Ya sirra sirri" : " 0 conscience de ma conscience: Si je m'excusais, envers Toi, ce serait (arguer) de mon ignorance (de Ton Ubiquité), de l'énormité (coupable) de mon doute (sur notre union), de l'excès de mon bégaiement alors que Tu m'as pris pour porte-parole". Ou encore: "Un mystère longtemps gardé te fut révélé : Un matin se leva dont tu fus les ténèbres / Le mystère de Son absence, c'est toi qui le caches au coeur / Il n’y aurait pas apposé Son scellé n'était toi" (muqatta’a 52, traduction SamiAli). Mais chez Hallâj l'allusion est plus qu'un moyen de dire le plus avec le moins, de cacher le Secret, tout en le dévoilant. Elle est l'unique forme possible du cri de l'extase. Il s'en explique, lui-même, dans sa muqatta’a 55, traduction Sami-Ali : " Loin de moi, loin de moi l'affirmation de deux / A jamais mon non-être est pour Toi un être / Et mon tout est en tout équivoque au visage double / Où donc est Ton être là où je regarde? / Car déjà mon être est là où il n'y a pas "où" / Et où est Ton visage que je cherche du regard? Dans la vision du coeur? Dans la vision de l'oeil? » Il s'agit pour Hallâj d'être par la parole aussi près que possible du silence car seul le silence devrait rendre ce qui dépasse la parole. Il s'agit de saisir l'insaisissable. Le symbole auquel recourent le plus souvent les poètes n'y suffit pas. Il y faut l'allusion, qui, comme un trait de feu, est la lumière même: "Les lumières de la lumière de la Lumière ont des lumières dans la création" dit Hallâj (muqatta’a 22). Nous sommes ici à la limite du communicable. Une brève image, brusque, violente, suffit, comme "les cavales de l'éloignement" (qâsida 3), ou "les jardins des signes" (muqatta’a 40). A la limite du communicable sont précisément les mots à double sens contraire, les addad, dont Hallâj se délecte. Sami-Ali a fait l'analyse du caractère paradoxal de ce phénomène dans un article de la Nouvelle Revue de psychanalyse, (1980, n°XXIII) Le langage mystique a pris les addad au Coran. Ils sont le meilleur recours du mystique pour voiler et dévoiler en même temps, dire et ne pas dire, Nous avons affaire à une pensée qui n'exclut pas la contradiction. Coincidentia oppositorum, n'est-ce pas une façon, sinon de définir, du moins d'atteindre
Sujet de méditation:
«Unifie moi, ô mon Unique (en Toi)
En me faisant vraiment confesser que Dieu est Un
Par un acte où aucun chemin ne serve de route!
Je suis vérité en puissance, et comme la Vérité en acte (al Haqq) est son propre potentiel,
Que notre séparation ne soit plus!...»
wa salam
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
( Le Diwan d'al-Hallâj) Husayn Mansur Hallaj(vers 857-922)
02/02/2008 20:34
( Le Diwan d'al-Hallâj)
| Husayn Mansûr HALLÂJ (env 857- 922) |
(1) Ton Esprit s'est emmêlé à mon espnt, comme l'ambre s'allie au musc odorant.
(2) Que l'on Te touche, on me touche; ainsi, Toi, c'est moi, plus de séparation.
***
(1) Je suis devenu Celui que j'aime, et Celui que j'aime est devenu moi ! Nous sommes deux esprits, infondus en un (seul) corps !
(2)Aussi, me voir, c'est Le voir, et Le voir, c'est nous voir.
***
(1) "Ah !", est-ce moi, est-ce Toi ? Cela ferait deux dieux. Loin de moi, loin de moi la pensée d'affirmer "deux"!
(2) Il y a une ipséité tienne, au fond de mon néant pour toujours, et mon tout, par dessus toutes choses, s'équivoque d'un double visage.
(3) Où donc est Ton essence, hors de moi, pour que j' y voie clair? Mais déjà mon essence s'élucide, au point qu'elle n'a plus de lieu.
(4) Et où retrouver Ton visage, objet de mon double attrait, au nadir de mon coeur ou au nadir de mon œil ?
(5) Entre moi et Toi, il y a un "c'est moi" qui me tourmente, ah ! enlève par Ton "c'est Moi", mon "c'est moi " hors d'entre nons deux!
***
(1)J'ai essayé de prendre patience, mais mon coeur peut-il patienter, privé de son centre ?
(2) Ton Esprit s'est peu à peu mêlé à mon Esprit, faisant alterner rapprochements et délaissements.
(3) Et maintenant je suis Toi-même, Ton existence c'est la mienne, et c'est aussi mon vouloir.
Qu'Allâh(swt) nous aide !
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Chaykh Ibrahima Niass(raa)
02/02/2008 20:16
|
|
Assalam alaykoum wa rahmatoullah ta'ala wa barakatouh
«Allâhumma salli `ala Sayyidinâ Muhammadin-il fâtihi limâ ughliqa
wal khâtimi limâ sabaqa nâsiril haqqi bil haqqi
wal hâdy ila siratikal mustaqîm
wa 'ala âlihi haqqa qadrihi wa miqdarihi-l-`adhîm.»
Le plus grand savant du hadith d'al-azhar de son temps, le chaykh mohammad al-hafidh, a dit que le chaykh Ibrahima Niasse(raa) avait le rang de Houjja dans le hadith (Celui qui connait plus de 300 000 ahadith par coeur avec leur chaîne de transmission et la biographie des narrateurs). 
|
Chaykh Ibrahima Niass(raa) avait le rang de Houjja dans le hadith (Celui qui connait plus de 300 000 ahadith par coeur avec leur chaîne de transmission et la biographie des narrateurs). 
Qu'Allâh(swt) l'accueille dans son "Jannat Al-Firdaws" auprès de sa "léila",le prophète Muhammad(saw) !
Djeureudjeuffe Baye !
|
|
 |
|
|
|
|
|
|