|
|
[ Photos ] [ Soufisme-citations ] [ DIWAN ] [ Questions à la Tijaniyya ] [ Informatique ] [ Rappels&Sagesses ] [ Fiqh-Jurisprudence ] [ Al-Hissane ] [ hadiths ]
|
|
|
| |
Est-il raisonnable que votre existence soit un simple accident de parcours sans nulle raison d'être ???
10/12/2007 18:09
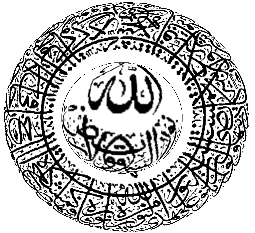
Est-il raisonnable que votre existence soit un simple accident de parcours sans nulle raison d'être ???
Un voyage sans destination est un voyage tellement absurde qu’il ne mérite même pas d’être entamé !
Il en est de même pour une épreuve sans résultat escompté ni aucune rétribution au bout, n’est pas moins absurde, au point que toute personne sensée, ne serait sûrement pas prête à s’y engager.
Or ,la vie n’est-elle pas en même temps un voyage et une épreuve ?
Est-il sensé qu’elle soit sans but ?
Doit-elle faire exception pour être absurde dans cet univers parfaitement bien organisé et bien agencé de son infiniment petit à son infiniment grand et qui jouit d’une harmonie pérenne ?
La paire de chaussures a une raison d’être !
l’homme en revanche, aurait-il moins de valeur que sa paire de chaussures pour ne pas avoir sa propre raison d'être ?
Et vous,qu'en dites-vous,chers visiteurs de mon Blog «Taîba-Niassène» ?
Vos analyses et vos reflexions m'intèressent ! Ne vous taisez pas s'il vous ! Animez mon blog en publiant des articles ayant trait soit au Saint Qur'ane ou à l'exégèse ou aux Hadiths ou bien par de simples commentaires !
Qu'Allâh(swt) vous rétribue au centuple !
wa salam
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA TRADITION MYSTIQUE MUSULMANE: FORMATION Á L’EXCELLENCE.
10/12/2007 17:35
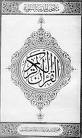
L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA TRADITION MYSTIQUE MUSULMANE: FORMATION Á L’EXCELLENCE.
Mohammed MELYANI
Maître de conférences
Université de Picardie Jules Verne. CURSEP.
Résumé: Le cheminement et l’accompagnement mystiques, en Islam, sont comparables à un voyage, dont le but est la recherche de l’excellence. Cette Voie est suivie par le Mourid (disciple), accompagné par un Maître spirituel, qui va le former, dans l’objectif ultime de la réalisation de l’Homme universel, symbole de l’unité interne de toutes les créatures.Cet accompagnement se manifeste également dans les activités professionnelles: la création d’un bel ouvrage rapproche de la connaissance divine, de la recherche de la qualité. Par tous ces aspects ( voie initiatique, ésotérique, formation), il se « rapproche » du compagnonnage en France.
Descripteurs: Islam; Formation; Compagnonnage; Accompagnement; Histoire de vie; Mysticisme; Qualité; Excellence.
Le compagnonnage dans la tradition musulmane trouve son origine dans la « voie ou Chemin » (Tariqa), que devait suivre les futurs compagnons. Cette voie avait toujours été considérée comme celle de la vérité et de la bonne direction, tant par les compagnons du Prophète(saw) (les premiers compagnons dans l’histoire de l’Islam) que par leurs disciples immédiats et par leurs successeurs. Ainsi, le mysticisme était regardé comme le chemin de la vérité et du salut par les premiers musulmans et par leurs hommes illustres, les compagnons du Prophète(saw), les successeurs de la génération suivante.
Cette voie repose sur l’ascétisme, le renoncement, la dévotion et l’imitation (de la vie des premiers compagnons du Prophète), choses courantes chez les compagnons du Prophète (saw) et les premiers musulmans, qui d’ailleurs ont tracé cette voie. La voie mystique est entièrement fondée sur l’examen intime des actions et des omissions et sur l’exposé des divers modes de « gustations » spirituelles et d’extases produites par les expériences mystiques. En voici l’explication: « L’homme se distingue des autres animaux par sa faculté de « perception » (idrâk). Celle-ci est de deux sortes: la première se porte sur les sciences et les connaissances, qu’elles soient certaines, conjecturales, douteuses ou imaginaires; l’autre a pour objet les « états » (hâl) qu’il éprouve en lui-même: joie et chagrin, anxiété et détente, satisfaction, colère, patience, gratitude, ... La «pensée ou sens» (al-ma’nâ) raisonnante et active provient de perceptions, de volitions et d’états (qui distinguent l’homme des animaux) et découlent les uns des autres. C’est ainsi que la science provient des «preuves» (adilla), le chagrin ou la joie, des choses pénibles ou agréables, l’activité est le produit du repos et l’inertie de la fatigue .
Les «exercices» (mujâhada) de piété chez le mystique novice doivent produire en lui un « état » (hâl), qui peut être comme un acte d’adoration et, une fois enraciné, devenir une véritable «station» (maqâm) spirituelle. Cet état peut aussi n’être qu’un attribut de l’âme: joie ou tristesse, énergie ou passivité, par exemple.
En Islam, la vie mystique, où s’inscrit l’Histoire de vie, est comparée à un voyage. La personne (mystique) avance le long d’un chemin; au fur et à mesure qu’elle avance dans son voyage, elle passe par différentes étapes (stations, stades, obstacles...) et par différents états (ou expériences). Tous ces degrés reposent sur l’obéissance (at-tâ’a= «obéissance, discipline,... ») et la sincérité (iklâs= «sincérité, fidélité, ... »). La foi les précède et les accompagne. On passe, successivement, de l’une à l’autre, jusqu’à l’ultime étape ou station de l’Unicité et de la «gnose» (‘irfân) divine. Si le «résultat» (natîja) fait apparaître quelque imperfection ou défaut, on peut être sûr que l’une ou l’autre existait déjà à la station précédente. Il en est de même des idées de l’âme et des «inspirations» (wâridât) du coeur. Il faut donc que le mystique novice procède à l’introspection (muhâsabat nafsi-h= «introspection, rendre compte de ses actions») de tous ses actes et qu’il scrute les replis secrets (de son coeur): car les actes produisent forcément des résultats et ceux-ci sont défectueux si ceux-là étaient imparfaits. Ce chemin de « l’excellence » que le mystique novice devra suivre, grâce au sens de la « gustation » spirituelle et par la voie de l’introspection, est vécu comme un voyage initiatique.
Ce voyage (mystique) vécu comme une « véritable » Histoire de vie, étant essentiellement une expérience individuelle, il s’ensuit que deux personnes (mystiques) ne peuvent jamais avoir d’expériences identiques au cours du même voyage.
Le but du voyageur, dans une Histoire de vie parfaitement organisée et accompagnée par un guide (c’est-à- dire par un ancien qui conduit le compagnon jusqu’au stade de la perfection), est de franchir les différentes étapes (stations) de la voie mystique, et d’en vivre les états (ou expériences) successifs jusqu’au point d’atteindre le stade le plus élevé. Le voyageur cesse alors d’être un novice cherchant la connaissance pour devenir un maître-connaisseur.
Cependant, là où la connaissance rejoint son propre être, et où l’Etre se connaît lui-même dans son immuable actualité, on ne saurait plus parler de l’homme. Dans la mesure où l’esprit plonge dans cet état, et où la vie s’inscrit dans cette histoire, la personne s’identifie, non pas à l’homme individuel, mais à l’Homme universel (homme complet ou parfait), qui constitue l’unité interne de toutes les créatures. L’Homme universel est le tout: c’est une transposition de l’individuel à l’universel qu’on appelle « homme »; il est, essentiellement, le prototype éternel, illimité et « divin » de tous les êtres.
Être « l’Homme universel » en tant que « synthèse de toutes les réalités essentielles de l’existence » est l’aboutissement suprême du compagnonnage et de l’histoire individuelle.
L’Homme universel est le pôle autour duquel évoluent les sphères de l’existence, de la première à la dernière; il est unique tant que l’existence dure... Cependant, il revêt différentes formes et se révèle par les divers cultes, en sorte qu’il reçoit des noms multiples. A chaque époque, il a le nom qui correspond à son vêtement actuel... C’est comme si l’on voit dans un rêve une personne revêtue de la forme d’une autre...avec cette réserve cependant qu’il y a une grande différence entre l’état de rêve et celui de veille... .
L’accompagnement en Histoire de vie, dans la tradition mystique, prend comme principe que chaque individu contient essentiellement, par son intelligence, la réalité de tous les autres, et même de toute chose existante. En effet, « chaque individu du genre humain contient les autres entièrement, sans défaut aucun, sa propre limitation n’étant qu’accident... Pour autant que les conditions accidentelles n’interviennent pas, les individus sont donc comme des miroirs opposés, dont chacun reflète pleinement l’autre... ». Seulement, certains individus ne contiennent les choses qu’en puissance, tandis que les autres, à savoir les parfaits (qui ont atteint la plénitude de l’homme universel), les contiennent en acte. Cela signifie qu’ils réalisent leur identité essentielle avec toute chose, car il est évident qu’ils ne contiennent pas les choses concrètement; il y a cependant des degrés dans cette « actualisation » de l’Histoire de vie (de l’homme), la plénitude parfaite n’appartenant qu’à l’Homme universel qui, lui, s’identifie au prophète Muhammad(saw). Il en est nécessairement ainsi selon la perspective de l’Islam, puisque chaque tradition connaît l’Homme universel à travers son propre pôle spirituel.
Dans la tradition musulmane, qui se veut totalité et qui engage l’être dans tous ses aspects, la spiritualité ne signifiera pas retraite vers le sacré, mais intégration du sacré dans tous les éléments de l’existence. C’est ainsi que le soufisme sera riche de dimensions scientifiques et artistiques, et qu’il jouera, par ailleurs, sur la scène de l’histoire, un rôle social, économique et politique souvent fort important.
Le «mysticisme» en Islam est plus connue sous le nom de « soufisme ». Il a pour but une connaissance dont la nature intime est « mystère » et qui ne peut être pleinement communiquée par la parole. Son organe n’est pas le cerveau mais le coeur, où la connaissance et l’être de l’homme coïncident. En son essence, le soufisme, est une voie spirituelle, et plus précisément une voie ésotérique et initiatique. C’est une voie ésotérique parce qu’il s’ordonne autour d’une doctrine selon laquelle toute réalité comporte un aspect extérieur apparent (ou exotérique), et un aspect intérieur caché (ou ésotérique); le soufisme se présente lui-même comme l’aspect intérieur et ésotérique de l’Islam. C’est une voie initiatique parce que le disciple (le Mourid= terme qui signifie celui qui «veut..., qui cherche à être...., apprenant..., celui qui a de la volonté... »), après avoir reçu l’initiation, aspire à réaliser sous la conduite de «Maître spirituel» (un Šayh l’ancien), des états de conscience toujours plus intérieurs, en procédant à l’introspection de tous ses actes et scrute les replis les plus secrets de son coeur.
Le «Maître spirituel » (le Šayh), a une fonction d’accompagnateur. Il transmet au « Mourid » ou disciple, l’influx spirituel qui vient féconder son âme et éveiller ce qui dort en elle. Le Mourid est alors relié à une chaîne de maîtres spirituels, il suivra son Maître sans que le lien qui les unit n’apparaisse extérieurement.
L’accompagnement (ou la fréquentation) du Maître (de l’ancien) est le moyen le plus sûr d’atteindre le stade suprême (celui de la reconnaissance de l’Unité divine, gnose qui est le terme voulu du bonheur) et de parfaire sa formation.
Dans toute l’acception de ce terme, le Maître spirituel (le Šayhl’ancien), conduit le Mourid jusqu’au stade de la perfection par sa seule présence, lui montre la lumière et la beauté du Très Haut et lui révèle les mystères de la montée vers Dieu .
Un bon Maître spirituel dirige son disciple par l’amour (en donnant la préférence au disciple) et l’amène jusqu’au stade de la contemplation, qui ne saurait être atteint par nul autre moyen en dehors de l’accompagnement (ou la fréquentation) du Maître.
L’amitié d’un bon Maître spirituel, avec tout ce que cela comporte: amour, fidélité, concentration du coeur, dévouement, esprit de sacrifice, humilité, obéissance, sincérité, est suffisante pour refléter la lumière et la connaissance (divine) dans le coeur du Mourid et pour l’orner de cette lumière.
L’attachement au Maître spirituel et son accompagnement (ou fréquentation) sont suffisants pour obtenir le reflet de la beauté de (son ) coeur, même si l’on est éloigné de lui, car la fonction d’accompagnement place le Mourid sous la protection du Maître spirituel qui le protège en toute circonstance, au point que le Mourid disparaît dans l’image du Maître, abondonne sa volonté propre et finit par n’exister que par la volonté du Maître. Alors, par l’intermédiaire du Maître, la connaissance (l’apprentissage) atteint le coeur du Mourid. Le Maître est perçu comme une source d’inspiration, et celui qui fait pénétrer cette source dans son coeur, atteindra le stade de l’inspiration.
Le Mourid reste ainsi en la compagnie de son Maître spirituel jusqu’à ce qu’il atteigne le degré de l’autonomie.
Dans le processus du cheminement mystique, quatre phases reviennent de manière précise et insistante dans le langage imagé utilisé pour penser la « formation » du Mourid ou le compagnonnage dans la tradition mystique:
1- Phase d’abandon, de séparation ou de détachement: comme le jeune marié qui abandonne sa vie de célibat, ou comme le prêtre novice qui abandonne « le monde ». Cette phase souligne une curiosité passionnée de la vie intérieure, un détachement de la surface agitée du moi et, le plus étonnant, un retrait au-delà du caprice de l’événement, une repentance, une abstinence, une renonciation, une pauvreté.
2- Phase d’initiation, de fréquentation d’un maître et de maturation. Une caractéristique fondamentale se révèle: le Mourid s’efface devant l’objet de son amour (Dieu(swt) ), il s’exprime d’une manière ramassée, dans la densité des paroles révélées, dans une foi dépouillée. L’amour, en tant que jouissance (quand il s’agit de la créature), et en tant qu’anéantissement (quand il s’agit de Dieu), constitue pour le Mourid une sorte de constellation organisée autour du schème de la maturation. L’amour du Mourid pour Dieu, c’est la conscience de Sa grandeur, qui occupe les profondeurs de son être et qui exclut toute autre vénération. Et l’amour de Dieu pour le Mourid, c’est de l’éprouver par lui-même, le rendant ainsi impropre à tout ce qui n’est pas Lui.
3- Phase de renforcement, d’exploration et de certitude: c’est l’enlèvement du doute, la contemplation,... c’est quand cesse ce qui faisait obstacle à la perpétuation du « moment » privilégié. C’est le processus qui permet au Mourid de joindre ce qui est distinct et de se séparer de ce qui se trouve entre les réalités distinctes. Dans cette phase, tout ce que voient les yeux concerne le savoir, et tout ce que savent les coeurs concerne la certitude.
4- Phase de dévoilement, de métamorphose et de passage: le dévoilement et la métamorphose forment le substrat de la « formation » du Mourid, ils touchent la voix, le niveau du langage, la manière de s’habiller et de vivre, la démarche, la posture,... alors le Mourid voit (d’autres) mondes, invisibles au commun des mortels; le voile se retire, l’esprit passe de la perception externe à l’interne, les sens faiblissent, tandis que l’esprit se fortifie, prend le dessus et se renouvelle. Il continue à se développer: il savait - maintenant, il voit. Le voile de la perception sensorielle s’écarte et l’âme accomplit son existence, essentielle, qui n’est autre que la «Perception» (Idrâk). L’esprit est alors prêt à recevoir les dons divins, les sciences mystiques et les bienfaits de Dieu. Son essence réalise sa vérité profonde et se rapproche du suprême horizon : celui des anges. Ce retrait du voile arrive souvent aux mystiques, qui perçoivent, comme personne, les réalités de l’Existence. Grâce à leur détermination (mentale) et à leurs pouvoirs psychiques, ils se meuvent librement au milieu des êtres inférieurs, qui sont contraints de leur obéir. Ce dévoilement constitue bien, en effet, un prototype de changement radical, de métamorphose du Mourid, de passage instantané d’un état ou d’un monde à un autre.
Lorsque nous parlons des sciences et des arts dans le soufisme, il faut bien distinguer deux cas: le premier est celui de l’activité professionnelle qu’exerce en principe la «personne mystique» «le soufi»: cette activité peut fort bien appartenir au domaine scientifique ou artistique, et cela d’autant plus que l’étude de tout ce qui concerne l’apparence des choses relève encore et toujours, pour lui, de la connaissance du Divin (puisque « l’apparent » est un non Divin).
Dans la tradition d’accompagnement « professionnelle » en Islam, notamment dans le soufisme, on considère que les activités professionnelles doivent servir à s’entraider, à supprimer ses propres convoitises, à se tourner vers autrui, et à se pencher vers son voisin. On estime aussi qu’elles ont un caractère obligatoire pour tous ceux dont dépendent des personnes qu’ils ont le devoir de prendre en charge.
La conduite à tenir dans les activités, c’est d’en faire de beaux ouvrages qui rapprochent de la connaissance du Divin. L’individu soufi doit s’en occuper comme s’il s’agissait d’ oeuvres surérogatoires (ce qu’on fait au-delà de ce qui est dû ou obligé) qui lui sont recommandées, et non pas avec l’idée qu’elles lui procurent des moyens de subsistance et lui apportent des avantages. C’est cela qui explique, peut-être, le degré de perfectionnement et de qualité atteint dans les ouvrages artisanaux dans les différents métiers (bois, arabesques,...). Ce perfectionnement est le symbole d’une beauté d’âme qui s’apparente humainement à l’Homme universel ou Homme complet (excellent, parfait,...).
La recherche de la qualité, dans de tels ouvrages, traduit la beauté intérieure qui comporte la simplicité, l’ampleur et l’harmonie ou équilibre, elle est déjà le fruit d’un attachement divin, bien qu’elle n’ait qu’une réalité subjective et qu’elle ne pourra jamais revendiquer la portée objective et générale de l’idée.
Quand un artisan ou un apprenti par exemple « savoure » une qualité dans sa réalité immédiate, il atteint par là, d’une certaine manière, la source ontologique infinie de toutes les qualités, l’Etre, et il voit l’aspect limité et individuel des choses comme une écorce vaine et illusoire, incomparable à ce que ces mêmes choses impliquent de qualitatif et d’illimité.
Notons que ces qualités sont, d’une manière générale, des idées définies, elles sont les « aspects » par lesquels Dieu se révèle d’une manière relative. C’est ainsi, du moins, que le rapport se présente du côté humain (ou du côté de l’artisan), car en principe ce sont les choses créées qui constituent les contenus virtuels des qualités divines, celles-ci contenant le monde comme une moindre réalité.
La plénitude d’une qualité (d’un bel ouvrage) implique une « indéfinité » d’aspects, à savoir toutes ses manifestations ou applications. Et connaître une qualité essentiellement, c’est l’intégrer dans l’essence dont elle émane.
L’assimilation des qualités comporte un processus graduel. La qualité dépend de son sujet, c’est-à-dire que dans une Histoire de vie ou dans une relation d’accompagnement par exemple, la personne ne s’approprie ni les qualités d’autrui ni ses propres qualités et qu’elle ne les possède d’aucune manière, avant qu’elle ne sache qu’elle est le sujet même dont elles dépendent, et qu’elle réalise qu’elle est celui qui connaît; c’est alors seulement que la connaissance sera vraiment sienne, et dès lors sa certitude n’aura plus besoin de confirmations, car la qualité est inséparable de son sujet.
L’examen du système du « compagnonnage » mystique nous permet de comprendre à quelles logiques peuvent obéir la « formation » du Mourid, et l’action de ses principes organisateurs que sont les « constellations » ou les « stations », lieux de passage et schèmes de l’imaginaire. La « formation » mystique commence en effet par une lente maturation (abandon et détachement d’un état antérieur) probatoire du noviciat, se poursuit par une introspection et une exploration interne, et s’achève par le dévoilement et l’unicité, forme de gnose divine. A ce stade, le Mourid s’identifie à l’Homme universel (une certaine conception de l’Homme qui a atteint sa complétude, une perception de la qualité et de l’excellence ). Dans cet exemple mystique de formation compagnonnique, on ne peut s’empêcher de constater la ressemblance frappante de ce parcours avec la tradition du compagnonnage en France (institution que certains « compagnons » font remonter à Salomon). La formation du compagnon commence aussi par une lente maturation, se poursuit par une véritable exploration du territoire national que constitue le « Tour de France », et s’achève par l’élaboration et la présentation du « chef d’oeuvre » marquant la passage à l’état de compagnon.
BIBLIOGRAPHIE:
Tables des matières
A- De l’Histoire de vie comme voyage à l’accompagnement mystique pour « être » un « Homme universel » (ou Homme complet).
B- Accompagnement et cheminement mystique: de la relation au maître et au disciple.
C- Accompagnement et activités professionnelles: de la qualité à l’excellence
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA TRADITION MYSTIQUE MUSULMANE: FORMATION Á L’EXCELLENCE.
10/12/2007 17:34
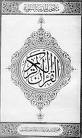
L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA TRADITION MYSTIQUE MUSULMANE: FORMATION Á L’EXCELLENCE.
Mohammed MELYANI
Maître de conférences
Université de Picardie Jules Verne. CURSEP.
Résumé: Le cheminement et l’accompagnement mystiques, en Islam, sont comparables à un voyage, dont le but est la recherche de l’excellence. Cette Voie est suivie par le Mourid (disciple), accompagné par un Maître spirituel, qui va le former, dans l’objectif ultime de la réalisation de l’Homme universel, symbole de l’unité interne de toutes les créatures.Cet accompagnement se manifeste également dans les activités professionnelles: la création d’un bel ouvrage rapproche de la connaissance divine, de la recherche de la qualité. Par tous ces aspects ( voie initiatique, ésotérique, formation), il se « rapproche » du compagnonnage en France.
Descripteurs: Islam; Formation; Compagnonnage; Accompagnement; Histoire de vie; Mysticisme; Qualité; Excellence.
Le compagnonnage dans la tradition musulmane trouve son origine dans la « voie ou Chemin » (Tariqa), que devait suivre les futurs compagnons. Cette voie avait toujours été considérée comme celle de la vérité et de la bonne direction, tant par les compagnons du Prophète(saw) (les premiers compagnons dans l’histoire de l’Islam) que par leurs disciples immédiats et par leurs successeurs. Ainsi, le mysticisme était regardé comme le chemin de la vérité et du salut par les premiers musulmans et par leurs hommes illustres, les compagnons du Prophète(saw), les successeurs de la génération suivante.
Cette voie repose sur l’ascétisme, le renoncement, la dévotion et l’imitation (de la vie des premiers compagnons du Prophète), choses courantes chez les compagnons du Prophète (saw) et les premiers musulmans, qui d’ailleurs ont tracé cette voie. La voie mystique est entièrement fondée sur l’examen intime des actions et des omissions et sur l’exposé des divers modes de « gustations » spirituelles et d’extases produites par les expériences mystiques. En voici l’explication: « L’homme se distingue des autres animaux par sa faculté de « perception » (idrâk). Celle-ci est de deux sortes: la première se porte sur les sciences et les connaissances, qu’elles soient certaines, conjecturales, douteuses ou imaginaires; l’autre a pour objet les « états » (hâl) qu’il éprouve en lui-même: joie et chagrin, anxiété et détente, satisfaction, colère, patience, gratitude, ... La «pensée ou sens» (al-ma’nâ) raisonnante et active provient de perceptions, de volitions et d’états (qui distinguent l’homme des animaux) et découlent les uns des autres. C’est ainsi que la science provient des «preuves» (adilla), le chagrin ou la joie, des choses pénibles ou agréables, l’activité est le produit du repos et l’inertie de la fatigue .
Les «exercices» (mujâhada) de piété chez le mystique novice doivent produire en lui un « état » (hâl), qui peut être comme un acte d’adoration et, une fois enraciné, devenir une véritable «station» (maqâm) spirituelle. Cet état peut aussi n’être qu’un attribut de l’âme: joie ou tristesse, énergie ou passivité, par exemple.
En Islam, la vie mystique, où s’inscrit l’Histoire de vie, est comparée à un voyage. La personne (mystique) avance le long d’un chemin; au fur et à mesure qu’elle avance dans son voyage, elle passe par différentes étapes (stations, stades, obstacles...) et par différents états (ou expériences). Tous ces degrés reposent sur l’obéissance (at-tâ’a= «obéissance, discipline,... ») et la sincérité (iklâs= «sincérité, fidélité, ... »). La foi les précède et les accompagne. On passe, successivement, de l’une à l’autre, jusqu’à l’ultime étape ou station de l’Unicité et de la «gnose» (‘irfân) divine. Si le «résultat» (natîja) fait apparaître quelque imperfection ou défaut, on peut être sûr que l’une ou l’autre existait déjà à la station précédente. Il en est de même des idées de l’âme et des «inspirations» (wâridât) du coeur. Il faut donc que le mystique novice procède à l’introspection (muhâsabat nafsi-h= «introspection, rendre compte de ses actions») de tous ses actes et qu’il scrute les replis secrets (de son coeur): car les actes produisent forcément des résultats et ceux-ci sont défectueux si ceux-là étaient imparfaits. Ce chemin de « l’excellence » que le mystique novice devra suivre, grâce au sens de la « gustation » spirituelle et par la voie de l’introspection, est vécu comme un voyage initiatique.
Ce voyage (mystique) vécu comme une « véritable » Histoire de vie, étant essentiellement une expérience individuelle, il s’ensuit que deux personnes (mystiques) ne peuvent jamais avoir d’expériences identiques au cours du même voyage.
Le but du voyageur, dans une Histoire de vie parfaitement organisée et accompagnée par un guide (c’est-à- dire par un ancien qui conduit le compagnon jusqu’au stade de la perfection), est de franchir les différentes étapes (stations) de la voie mystique, et d’en vivre les états (ou expériences) successifs jusqu’au point d’atteindre le stade le plus élevé. Le voyageur cesse alors d’être un novice cherchant la connaissance pour devenir un maître-connaisseur.
Cependant, là où la connaissance rejoint son propre être, et où l’Etre se connaît lui-même dans son immuable actualité, on ne saurait plus parler de l’homme. Dans la mesure où l’esprit plonge dans cet état, et où la vie s’inscrit dans cette histoire, la personne s’identifie, non pas à l’homme individuel, mais à l’Homme universel (homme complet ou parfait), qui constitue l’unité interne de toutes les créatures. L’Homme universel est le tout: c’est une transposition de l’individuel à l’universel qu’on appelle « homme »; il est, essentiellement, le prototype éternel, illimité et « divin » de tous les êtres.
Être « l’Homme universel » en tant que « synthèse de toutes les réalités essentielles de l’existence » est l’aboutissement suprême du compagnonnage et de l’histoire individuelle.
L’Homme universel est le pôle autour duquel évoluent les sphères de l’existence, de la première à la dernière; il est unique tant que l’existence dure... Cependant, il revêt différentes formes et se révèle par les divers cultes, en sorte qu’il reçoit des noms multiples. A chaque époque, il a le nom qui correspond à son vêtement actuel... C’est comme si l’on voit dans un rêve une personne revêtue de la forme d’une autre...avec cette réserve cependant qu’il y a une grande différence entre l’état de rêve et celui de veille... .
L’accompagnement en Histoire de vie, dans la tradition mystique, prend comme principe que chaque individu contient essentiellement, par son intelligence, la réalité de tous les autres, et même de toute chose existante. En effet, « chaque individu du genre humain contient les autres entièrement, sans défaut aucun, sa propre limitation n’étant qu’accident... Pour autant que les conditions accidentelles n’interviennent pas, les individus sont donc comme des miroirs opposés, dont chacun reflète pleinement l’autre... ». Seulement, certains individus ne contiennent les choses qu’en puissance, tandis que les autres, à savoir les parfaits (qui ont atteint la plénitude de l’homme universel), les contiennent en acte. Cela signifie qu’ils réalisent leur identité essentielle avec toute chose, car il est évident qu’ils ne contiennent pas les choses concrètement; il y a cependant des degrés dans cette « actualisation » de l’Histoire de vie (de l’homme), la plénitude parfaite n’appartenant qu’à l’Homme universel qui, lui, s’identifie au prophète Muhammad(saw). Il en est nécessairement ainsi selon la perspective de l’Islam, puisque chaque tradition connaît l’Homme universel à travers son propre pôle spirituel.
Dans la tradition musulmane, qui se veut totalité et qui engage l’être dans tous ses aspects, la spiritualité ne signifiera pas retraite vers le sacré, mais intégration du sacré dans tous les éléments de l’existence. C’est ainsi que le soufisme sera riche de dimensions scientifiques et artistiques, et qu’il jouera, par ailleurs, sur la scène de l’histoire, un rôle social, économique et politique souvent fort important.
Le «mysticisme» en Islam est plus connue sous le nom de « soufisme ». Il a pour but une connaissance dont la nature intime est « mystère » et qui ne peut être pleinement communiquée par la parole. Son organe n’est pas le cerveau mais le coeur, où la connaissance et l’être de l’homme coïncident. En son essence, le soufisme, est une voie spirituelle, et plus précisément une voie ésotérique et initiatique. C’est une voie ésotérique parce qu’il s’ordonne autour d’une doctrine selon laquelle toute réalité comporte un aspect extérieur apparent (ou exotérique), et un aspect intérieur caché (ou ésotérique); le soufisme se présente lui-même comme l’aspect intérieur et ésotérique de l’Islam. C’est une voie initiatique parce que le disciple (le Mourid= terme qui signifie celui qui «veut..., qui cherche à être...., apprenant..., celui qui a de la volonté... »), après avoir reçu l’initiation, aspire à réaliser sous la conduite de «Maître spirituel» (un Šayh l’ancien), des états de conscience toujours plus intérieurs, en procédant à l’introspection de tous ses actes et scrute les replis les plus secrets de son coeur.
Le «Maître spirituel » (le Šayh), a une fonction d’accompagnateur. Il transmet au « Mourid » ou disciple, l’influx spirituel qui vient féconder son âme et éveiller ce qui dort en elle. Le Mourid est alors relié à une chaîne de maîtres spirituels, il suivra son Maître sans que le lien qui les unit n’apparaisse extérieurement.
L’accompagnement (ou la fréquentation) du Maître (de l’ancien) est le moyen le plus sûr d’atteindre le stade suprême (celui de la reconnaissance de l’Unité divine, gnose qui est le terme voulu du bonheur) et de parfaire sa formation.
Dans toute l’acception de ce terme, le Maître spirituel (le Šayhl’ancien), conduit le Mourid jusqu’au stade de la perfection par sa seule présence, lui montre la lumière et la beauté du Très Haut et lui révèle les mystères de la montée vers Dieu .
Un bon Maître spirituel dirige son disciple par l’amour (en donnant la préférence au disciple) et l’amène jusqu’au stade de la contemplation, qui ne saurait être atteint par nul autre moyen en dehors de l’accompagnement (ou la fréquentation) du Maître.
L’amitié d’un bon Maître spirituel, avec tout ce que cela comporte: amour, fidélité, concentration du coeur, dévouement, esprit de sacrifice, humilité, obéissance, sincérité, est suffisante pour refléter la lumière et la connaissance (divine) dans le coeur du Mourid et pour l’orner de cette lumière.
L’attachement au Maître spirituel et son accompagnement (ou fréquentation) sont suffisants pour obtenir le reflet de la beauté de (son ) coeur, même si l’on est éloigné de lui, car la fonction d’accompagnement place le Mourid sous la protection du Maître spirituel qui le protège en toute circonstance, au point que le Mourid disparaît dans l’image du Maître, abondonne sa volonté propre et finit par n’exister que par la volonté du Maître. Alors, par l’intermédiaire du Maître, la connaissance (l’apprentissage) atteint le coeur du Mourid. Le Maître est perçu comme une source d’inspiration, et celui qui fait pénétrer cette source dans son coeur, atteindra le stade de l’inspiration.
Le Mourid reste ainsi en la compagnie de son Maître spirituel jusqu’à ce qu’il atteigne le degré de l’autonomie.
Dans le processus du cheminement mystique, quatre phases reviennent de manière précise et insistante dans le langage imagé utilisé pour penser la « formation » du Mourid ou le compagnonnage dans la tradition mystique:
1- Phase d’abandon, de séparation ou de détachement: comme le jeune marié qui abandonne sa vie de célibat, ou comme le prêtre novice qui abandonne « le monde ». Cette phase souligne une curiosité passionnée de la vie intérieure, un détachement de la surface agitée du moi et, le plus étonnant, un retrait au-delà du caprice de l’événement, une repentance, une abstinence, une renonciation, une pauvreté.
2- Phase d’initiation, de fréquentation d’un maître et de maturation. Une caractéristique fondamentale se révèle: le Mourid s’efface devant l’objet de son amour (Dieu(swt) ), il s’exprime d’une manière ramassée, dans la densité des paroles révélées, dans une foi dépouillée. L’amour, en tant que jouissance (quand il s’agit de la créature), et en tant qu’anéantissement (quand il s’agit de Dieu), constitue pour le Mourid une sorte de constellation organisée autour du schème de la maturation. L’amour du Mourid pour Dieu, c’est la conscience de Sa grandeur, qui occupe les profondeurs de son être et qui exclut toute autre vénération. Et l’amour de Dieu pour le Mourid, c’est de l’éprouver par lui-même, le rendant ainsi impropre à tout ce qui n’est pas Lui.
3- Phase de renforcement, d’exploration et de certitude: c’est l’enlèvement du doute, la contemplation,... c’est quand cesse ce qui faisait obstacle à la perpétuation du « moment » privilégié. C’est le processus qui permet au Mourid de joindre ce qui est distinct et de se séparer de ce qui se trouve entre les réalités distinctes. Dans cette phase, tout ce que voient les yeux concerne le savoir, et tout ce que savent les coeurs concerne la certitude.
4- Phase de dévoilement, de métamorphose et de passage: le dévoilement et la métamorphose forment le substrat de la « formation » du Mourid, ils touchent la voix, le niveau du langage, la manière de s’habiller et de vivre, la démarche, la posture,... alors le Mourid voit (d’autres) mondes, invisibles au commun des mortels; le voile se retire, l’esprit passe de la perception externe à l’interne, les sens faiblissent, tandis que l’esprit se fortifie, prend le dessus et se renouvelle. Il continue à se développer: il savait - maintenant, il voit. Le voile de la perception sensorielle s’écarte et l’âme accomplit son existence, essentielle, qui n’est autre que la «Perception» (Idrâk). L’esprit est alors prêt à recevoir les dons divins, les sciences mystiques et les bienfaits de Dieu. Son essence réalise sa vérité profonde et se rapproche du suprême horizon : celui des anges. Ce retrait du voile arrive souvent aux mystiques, qui perçoivent, comme personne, les réalités de l’Existence. Grâce à leur détermination (mentale) et à leurs pouvoirs psychiques, ils se meuvent librement au milieu des êtres inférieurs, qui sont contraints de leur obéir. Ce dévoilement constitue bien, en effet, un prototype de changement radical, de métamorphose du Mourid, de passage instantané d’un état ou d’un monde à un autre.
Lorsque nous parlons des sciences et des arts dans le soufisme, il faut bien distinguer deux cas: le premier est celui de l’activité professionnelle qu’exerce en principe la «personne mystique» «le soufi»: cette activité peut fort bien appartenir au domaine scientifique ou artistique, et cela d’autant plus que l’étude de tout ce qui concerne l’apparence des choses relève encore et toujours, pour lui, de la connaissance du Divin (puisque « l’apparent » est un non Divin).
Dans la tradition d’accompagnement « professionnelle » en Islam, notamment dans le soufisme, on considère que les activités professionnelles doivent servir à s’entraider, à supprimer ses propres convoitises, à se tourner vers autrui, et à se pencher vers son voisin. On estime aussi qu’elles ont un caractère obligatoire pour tous ceux dont dépendent des personnes qu’ils ont le devoir de prendre en charge.
La conduite à tenir dans les activités, c’est d’en faire de beaux ouvrages qui rapprochent de la connaissance du Divin. L’individu soufi doit s’en occuper comme s’il s’agissait d’ oeuvres surérogatoires (ce qu’on fait au-delà de ce qui est dû ou obligé) qui lui sont recommandées, et non pas avec l’idée qu’elles lui procurent des moyens de subsistance et lui apportent des avantages. C’est cela qui explique, peut-être, le degré de perfectionnement et de qualité atteint dans les ouvrages artisanaux dans les différents métiers (bois, arabesques,...). Ce perfectionnement est le symbole d’une beauté d’âme qui s’apparente humainement à l’Homme universel ou Homme complet (excellent, parfait,...).
La recherche de la qualité, dans de tels ouvrages, traduit la beauté intérieure qui comporte la simplicité, l’ampleur et l’harmonie ou équilibre, elle est déjà le fruit d’un attachement divin, bien qu’elle n’ait qu’une réalité subjective et qu’elle ne pourra jamais revendiquer la portée objective et générale de l’idée.
Quand un artisan ou un apprenti par exemple « savoure » une qualité dans sa réalité immédiate, il atteint par là, d’une certaine manière, la source ontologique infinie de toutes les qualités, l’Etre, et il voit l’aspect limité et individuel des choses comme une écorce vaine et illusoire, incomparable à ce que ces mêmes choses impliquent de qualitatif et d’illimité.
Notons que ces qualités sont, d’une manière générale, des idées définies, elles sont les « aspects » par lesquels Dieu se révèle d’une manière relative. C’est ainsi, du moins, que le rapport se présente du côté humain (ou du côté de l’artisan), car en principe ce sont les choses créées qui constituent les contenus virtuels des qualités divines, celles-ci contenant le monde comme une moindre réalité.
La plénitude d’une qualité (d’un bel ouvrage) implique une « indéfinité » d’aspects, à savoir toutes ses manifestations ou applications. Et connaître une qualité essentiellement, c’est l’intégrer dans l’essence dont elle émane.
L’assimilation des qualités comporte un processus graduel. La qualité dépend de son sujet, c’est-à-dire que dans une Histoire de vie ou dans une relation d’accompagnement par exemple, la personne ne s’approprie ni les qualités d’autrui ni ses propres qualités et qu’elle ne les possède d’aucune manière, avant qu’elle ne sache qu’elle est le sujet même dont elles dépendent, et qu’elle réalise qu’elle est celui qui connaît; c’est alors seulement que la connaissance sera vraiment sienne, et dès lors sa certitude n’aura plus besoin de confirmations, car la qualité est inséparable de son sujet.
L’examen du système du « compagnonnage » mystique nous permet de comprendre à quelles logiques peuvent obéir la « formation » du Mourid, et l’action de ses principes organisateurs que sont les « constellations » ou les « stations », lieux de passage et schèmes de l’imaginaire. La « formation » mystique commence en effet par une lente maturation (abandon et détachement d’un état antérieur) probatoire du noviciat, se poursuit par une introspection et une exploration interne, et s’achève par le dévoilement et l’unicité, forme de gnose divine. A ce stade, le Mourid s’identifie à l’Homme universel (une certaine conception de l’Homme qui a atteint sa complétude, une perception de la qualité et de l’excellence ). Dans cet exemple mystique de formation compagnonnique, on ne peut s’empêcher de constater la ressemblance frappante de ce parcours avec la tradition du compagnonnage en France (institution que certains « compagnons » font remonter à Salomon). La formation du compagnon commence aussi par une lente maturation, se poursuit par une véritable exploration du territoire national que constitue le « Tour de France », et s’achève par l’élaboration et la présentation du « chef d’oeuvre » marquant la passage à l’état de compagnon.
BIBLIOGRAPHIE:
Tables des matières
A- De l’Histoire de vie comme voyage à l’accompagnement mystique pour « être » un « Homme universel » (ou Homme complet).
B- Accompagnement et cheminement mystique: de la relation au maître et au disciple.
C- Accompagnement et activités professionnelles: de la qualité à l’excellence
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LE SOUFISME, qu’est ce que c’est ?
10/12/2007 16:49

LE SOUFISME, qu’est ce que c’est ?
Le soufisme est le mysticisme de l’Islam. Comme tel, il a la particularité d’exister aussi bien dans l’Islam sunnite que dans l’Islam chiite. Décrire le soufisme est une tâche redoutable.
Comme tout mysticisme, il est avant tout une recherche de Dieu et son expression peut prendre des formes très différentes. D’autre part, par ses aspects ésotériques, il présente des pratiques secrètes, des rites d’initiation, eux aussi variables selon les maîtres qui l’enseignent.
Bien que le soufisme se veuille rigoureusement musulman, l’Islam traditionnel, sunnite et chiite, considère le soufisme avec la plus grande méfiance.
En Iran, la grande majorité des « mollas » y est vivement opposée et dans l’Islam sunnite, la plupart des «Ulema »sont beaucoup plus intéressés par la lettre du Coran et ses interprétations juridiques que par les spéculations des soufis auxquelles ils trouvent une odeur de soufre. Cette opposition généralisée contribue à la discrétion du soufisme.
En outre, le soufisme n’a aucune unité. Chaque maître se constitue une cohorte de disciples attirés par la réputation de son enseignement. Tout au plus, ces maîtres déclarent se rattacher à une " confrérie ", elle même fondée par un célèbre soufi des siècles passés ; personne ne vérifie une quelconque orthodoxie de l’enseignement donné, du moment qu’il se réfère à l’Islam.
L’importance de cet Islam secret n’en est pas moins remarquable. Historiquement, il a joué un rôle de premier plan dans la naissance des déviations du chiisme que sont l’Ismaëlisme et la religion druze. En littérature, il a profondément inspiré certaines des oeuvres arabo-persanes les plus remarquables comme les Contes des Mille et Une Nuits ou le poème d’amour de Leyla et Majnoun.
C’est cependant par sa spiritualité que le soufisme est le plus original. Dans la conception soufie, l’approche de Dieu s’effectue par degrés.
-Il faut d’abord respecter la loi du Coran, mais ce n’est qu’un préalable qui ne permet pas de comprendre la nature du monde. Les rites sont inefficaces si l’on ignore leur sens caché. Seule une initiation permet de pénétrer derrière l’apparence des choses. L’homme, par exemple, est un microcosme, c’est-à-dire un monde en réduction, où l’on trouve l’image de l’univers, le macrocosme. Il est donc naturel qu’en approfondissant la connaissance de l’homme, on arrive à une perception du monde qui est déjà une approche de Dieu.
Selon les soufis, toute existence procède de Dieu et Dieu seul est réel. Le monde créé n’est que le reflet du divin, " l’univers est l’Ombre de l’Absolu ". percevoir Dieu (swt)derrière l’écran des choses implique la pureté de l’âme. Seul un effort de renoncement au monde permet de s’élancer vers Dieu(swt):
" l’homme est un miroir qui, une fois poli, réfléchit Dieu ".
Le Dieu que découvrent les soufis est un Dieu d’amour et on accède à Lui par l’Amour :
" qui connaît Dieu, L’aime ; qui connaît le monde y renonce ! "
" Si tu veux être libre, sois captif de l’Amour ! "
Ce sont des accents que ne désavoueraient pas les mystiques chrétiens. Il est curieux de noter à cet égard les convergences du soufisme avec d’autres courants philosophiques ou religieux: à son origine, le soufisme a été influencé par la pensée pythagoricienne et par la religion zoroastrienne de la Perse ; l’initiation soufie, qui permet une re-naissance spirituelle, n’est pas sans rappeler le baptême chrétien et l’on pourrait même trouver quelques réminiscences bouddhistes dans la formule soufie " l’homme est non-existant devant Dieu ".
Même diversité et même imagination dans les techniques spirituelles du soufisme : la recherche de Dieu(swt) par le symbolisme passe, chez certains soufis, par la musique ou la danse qui, disent-ils transcende la pensée ; c’est ce que pratiquait Djalal ed din Roumi, dit Mevlana, le fondateur des derviche tourneurs ; chez d’autres soufis, le symbolisme est un exercice intellectuel où l’on spécule, comme le font les Juifs de la Kabbale, sur la valeur chiffrée des lettres ; parfois aussi, c’est par la répétition indéfinie de l’invocation des noms de Dieu que le soufi recherche son union avec Lui(swt).
Le soufisme apporte ainsi à l’Islam une dimension poétique et mystique qu’on chercherait en vain chez les exégètes pointilleux du texte coranique. C’est pourquoi ces derniers, irrités par ce débordement de ferveur, cherchent à marginaliser le soufisme. C’est pourquoi aussi les soufis tiennent tant à leurs pratiques en les faisant remonter au prophète(saw) lui-même: Mouhammad(saw) aurait reçu, en même temps que le Coran, des révélations ésotériques qu’il n’aurait communiquées qu’à certains de ses compagnons. Ainsi les maîtres soufis rattachent-ils tous leur enseignement à une longue chaîne de prédécesseurs qui les authentifie.
Cette légitimité par la référence au prophète (saw)n'entraîne cependant pas d'uniformisation du mouvement soufi : les écoles foisonnent et chacune a son style et ses pratiques. Ces écoles sont généralement désignées en français sous le nom de confréries. Avant de procéder à l'étude de quelques unes d'entre elles, il faut toutefois garder à l'esprit que les confréries sont devenues, non pas une institution, mais au moins une manière de vivre l'Islam si généralement admise que toutes sortes de mouvements, mystiques ou non, se parent du titre de confrérie pour exercer leurs activités. Qu'on ne s'étonne donc pas de rencontrer parfois des confréries fort peu mystiques à la spiritualité rudimentaire, bien éloignée des spéculations élevées qui ont fait du soufisme l'une des composantes majeures de la spiritualité universelle.
Michel Malherbes, (Les Religions de l’Humanité), pages 192-194 Ed. Critérion
Qu'Allâh(swt) nous donne le discernement et le savoir !
wa salam
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ibn ‘Arabî est surnommé le "shaykh al-akbar,"
08/12/2007 16:49
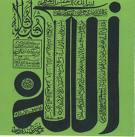
Ibn ‘Arabî
« Le réel est le Réel, le créaturel est le créaturel !»
La figure d’Ibn ‘Arabî qui domine toute « l’histoire moderne du mysticisme musulman » reste le Maître par excellence. Il est surnommé le shaykh al-akbar, il est aussi considéré comme le sceau de la sainteté. Mais, s’il est indéniable que son œuvre constitue une somme d’une importance considérable, on aurait tendance à croire que le soufisme antérieur devait aboutir à lui et qu’après lui il n’avait plus de raison d’être. C’est encore une fois l’histoire de l’arbre qui cache la forêt. Cela n’empêche pas qu’Ibn ‘Arabî reste une des plus importantes figures du soufisme, et le principal représentant de la voie de « l’unicité de l’être » (wahdat al-wujûd).
Ibn ‘Arabî est né en 1165, à Murcie. Il assiste aux funérailles d’Averroès à Cordoue, en 1198. Deux ans plus tard, il quitte définitivement l’Andalousie, pour l’Orient : Tunis, puis la Mekke, l’Anatolie, avant son installation définitive en Syrie, en 1223. Il y est mort le 8 novembre 1240.
Sans partager complètement l’opinion de Louis Massignon à son égard, force est de reconnaître que, même dans leurs élans les plus intimes, ses écrits gardent une grande sécheresse d’expression. Dire que Ibn ‘Arabî s’est reconnu très tôt « une âme de poète » est un abus de langage. De ce point de vue, on peut au moins lui préférer Hâfez Shirâzi et même Hallâj. Pourtant, Ibn ‘Arabî a expérimenté la voie de l’amour – c‘est toute son aventure amoureuse avec celle qui sera sa Béatrice : Nizâm – dont on peut dire que le cœur d’Ibn ‘Arabî sera un jour tout entier épris, comme ce fut le cas pour Dante avec Béatrice. Henry Corbin a écrit des pages admirables sur cette expérience de l’amour humain. Mais, lui-même aura sans doute manqué, si l'on peut dire, ce qui constitue le fond de la métaphysique
« akbarienne », à savoir « l’Homme universel » :
« Du point de vue de la Créature, l’univers est multiple, or la Création est Une. Au regard de l’Essence, « l’univers est comme un seul être ».
L’homme ordinaire ne perçoit donc de l’univers que sa multiplicité, tandis que le saint, le soufi, le perçoit dans son unicité, étant devenu lui-même un, « en ayant effectivement réalisé toutes les Vérités universelles qui se reflètent dans sa forme terrestre ». Ou, en d’autres termes, dès lors que « sa « réalité intérieure » s’identifie à celle de la totalité de l’univers ». Il sera alors identifié à l’ « Homme parfait », à l’« Homme universel », parce que, pour lui, les Réalités divines ne seront plus « voilées » par rien.
|
Commentaire de BEN Hosny (28/01/2008 12:52) :
L'imam Sufyan ath-Thawri, un grand savant du salaf, a dit :
"Le vrai savant c'est celui qui plonge dans le coeur du Coran et de la
Sunna afin d'en sortir une fatwa qui donne des solutions aux gens. Car
dire que tout est haram (interdit), sans rentrer dans le coeur des Textes,
tout le monde peut le faire".
|
|
Commentaire de safi (28/01/2008 13:18) :
"Et si Mon serviteur t'interroge à Mon sujet alors je suis tout
près... Je répond à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me
prie.... "
Wa idha sa-alaka 'ibadi 'anni fa inni quarib... Oujibou
da'wate ada'i idha da'anni...
|
|
|
|
|
|
|