|
|
[ Photos ] [ Soufisme-citations ] [ DIWAN ] [ Questions à la Tijaniyya ] [ Informatique ] [ Rappels&Sagesses ] [ Fiqh-Jurisprudence ] [ Al-Hissane ] [ hadiths ]
|
|
|
| |
Pourquoi le besoin d'une révélation en plus de la raison ?
04/12/2007 16:33
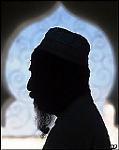
Pourquoi le besoin d'une révélation en plus de la raison ?
Aucune société humaine ne peut vivre sans limites, sans notion, même théorique, d'erreur morale. Les hommes ont besoin de repères !
Différentes questions se posent donc :
Sur quels critères s'appuyer pour s'orienter et se repérer ?
Pour s’orienter, l'homme peut-il se suffire de la lumière de son cœur et de sa raison ?
La raison sans le cœur et la raison qui raisonne avec l'accompagnement du cœur !
Pour l'islam, la raison est une faculté humaine qui est positive. A tel point que, d'après l'islam, celui qui est privé de raison, le fou, n'est pas tenu responsable de ses actes. Le mot "raison" a été employé sous cette forme nominale par le Prophète dans certains Hadîths.
Dans le Coran, seule la forme verbale "raisonner" a été employée par Dieu : "Penses-tu que la plupart d'entre eux écoutent ou raisonnent ? Ils ne sont que comme des animaux, ou même plus égarés !" (Coran 25/44).
Positive certes, mais la raison a ses limites : si la science rationnelle (basée sur l'observation et l'expérimentation) a révélé bien des mystères, elle explique une considérable partie du "comment" de l'univers, mais elle n'éclaire pas la question, très humaine, du "pourquoi" : pourquoi un univers plutôt que rien, pourquoi la vie, quelle est la finalité de mon existence…
De plus, si le savoir scientifique permet de comprendre les lois qui régissent le fonctionnement de l'univers et de réaliser grâce à elles des applications destinées à maîtriser la nature, ce seul savoir est, par définition, incapable de fournir à l’homme une "guidée", une éthique quant à l'utilisation de ces nouveaux outils :
"La science, en soi, disait Bertrand Russel, ne peut pas nous fournir une éthique. Elle peut nous indiquer comment atteindre un objectif et, parfois, nous montrer que certains objectifs sont inaccessibles. Mais parmi les objectifs réalisables, notre choix doit être guidé par des considérations autres que purement scientifiques."
Ceci est sans doute vrai aujourd'hui plus qu'hier, avec les énormes possibilités qu'offrent le génie génétique et la maîtrise technologique de l'énergie nucléaire. Ce le sera demain encore plus qu'aujourd'hui. Déjà, un peu partout en Europe apparaissent des comités consultatifs d'éthique, destinés à proposer des limites et orientations éthiques, donc d'une nature autre que celles purement rationnelles.
Enfin, si l'homme se voile le cœur et utilise sa raison seule, froide et calculatrice, sa raison, ne se mettant plus au service des hautes valeurs que souffle son cœur, se met alors à servir de ses intérêts et de ses désirs :
"Il n'est pas contraire à la raison pure que de préférer la destruction du monde à une égratignure du petit doigt." disait Hume.
La raison seule( pure et froide ) ne peut donc guider l'homme dans les choix qu'il doit faire. On peut dire qu' "il existe en l'homme autre chose, qui a ses raisons qui sont différentes de celles de la raison pure" : c'est le cœur. Par "cœur", on entend la conscience morale, une faculté humaine naturellement bonne. Pour l'islam, tout le monde possède un cœur, même ceux qui refusent et renient ce que celui-ci leur souffle : "Ils ont un cœur mais ne réfléchissent pas par lui" (Coran 7/179).
Et quand le Coran fait les éloges de ceux qui raisonnent, il parle bien de ceux qui raisonnement avec l'accompagnement de leur cœur : "N'ont-ils pas parcouru la terre et eu un cœur par lequel ils raisonnent ou des oreilles par lesquelles ils entendent ? Car ce ne sont pas les vues qui s'aveuglent, mais les cœurs qui sont dans les poitrines" (Coran 22/46).
C'est dans le cas où la raison accepte ce que le cœur lui souffle que l'homme "raisonne par son cœur" (c'est-à-dire avec l'accompagnement de son cœur).
Malgré tout, si le "cœur par lequel on raisonne" exerce certes une influence positive sur la conduite de l’homme, une autre influence existe aussi : celle des instincts, des désirs et des pulsions naturellement présents chez l’homme.
Et qui serait capable de distinguer réellement la voix de son cœur au milieu de toutes les incitations intérieures qu’il "ressent" ?
La psychanalyse l’a bien montré : ce dont on pourrait penser que c’est la voix de son cœur n’est parfois rien d’autre que les désirs enfouis dans les replis de son âme, ressurgissant déguisés sous une autre forme…
L’homme possède certes une nature d’essence bonne ; mais il est également sujet à des désirs personnels. Son cœur est là pour lui rappeler le juste, mais il est concurrencé par les désirs intérieurs, qui, eux aussi, soufflent à l'homme.
Une révélation venant approuver et orienter le cœur ; une révélation dans le cadre de quoi l'homme raisonne :
C'est ici que, selon l'islam, entre en jeu la Révélation, qui lui propose justement une lumière à partir de laquelle il puisse orienter ses pensées et ses actes. Une lumière désirant non pas contredire les facultés morales et intellectuelles qu’il possède naturellement, mais au contraire approuver et préserver la lumière originelle de son cœur. Une lumière qui vienne approuver, orienter et préserver la lumière innée de son cœur :
"Dieu est la Lumière des cieux et de la Terre. La parabole de Sa lumière est (celle-ci) : une niche dans laquelle se trouve une lampe ; la lampe se trouve à l’intérieur d’un (récipient de) cristal ; celui-ci ressemble à un astre éclatant ; (son combustible) vient d’un arbre béni, un olivier, qui n’a été orienté ni vers l’est ni vers l’ouest ; l’huile de cet olivier semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Dieu guide qui Il veut vers Sa lumière. Et Dieu cite (de la sorte) des paraboles aux hommes. Et Dieu est Omniscient" (Coran 24/ 35).
Au-delà de la seule beauté de ses phrases, ce verset contient une parabole : celle de la lumière de la révélation venant se superposer à la lumière du cœur de l’homme. Dans le verset, il est question d'une lampe qui en soi est performante au point qu'elle "semble éclairer sans même que le feu la touche", mais qui connaît ensuite, lorsqu'elle rencontre le feu : "lumière sur lumière" : le feu et sa lumière décuplent la lumière déjà présente dans la lampe (cf. Ma'ârif ul-qur'ân, Muftî Muhammad Shafî', tome 6 pp. 422-423).
Le verset part de cette image extraite de la vie quotidienne pour nous expliquer qu’à l’instar de la lampe conçue par l’homme pour éclairer, le cœur humain a été conçu par Dieu de façon à produire une orientation pour l’homme, aussi bien dans la dimension éthique que dans le domaine spirituel ; et que, de la même façon qu’aux capacités originelles de la lampe vient s’ajouter la lumière fournie par le feu, à la lumière originelle du cœur vient s’ajouter pour la confirmer, la préserver et l’orienter une autre lumière : la révélation divine. "Lumière sur lumière" : la lumière de la révélation se superpose à celle du cœur pour la préserver et l’orienter.
Muhammad Asad (mort en 1992), un homme d'origine autrichienne et juive, et converti à l'islam dans la première moitié du XXème siècle, écrit à ce sujet : "Malgré tout ce qui dans l'islam séduisait mon intellect, je ne comprenais pas qu'un homme intelligent puisse conformer toute sa pensée et toute sa manière de vivre à un système non élaboré par lui-même. – "Dites-moi, cheikh Mustafa, demandai-je un jour à mon savant ami Al-Maraghi, pourquoi devrait-il être nécessaire de se limiter soi-même à tel enseignement et à tel ensemble de prescriptions ?
Ne serait-il pas préférable de confier toute inspiration éthique à sa propre voix intérieure ?
– (...) La réponse est simple. Très peu nombreux - les prophètes seulement - sont les hommes réellement capables de comprendre la voix intérieure qui parle en eux. Nous sommes pour la plupart soumis à nos intérêts et désirs personnels, et si chacun devait suivre ce qu'il croit entendre de son propre cœur, ce serait un chaos moral complet, et nous ne pourrions jamais nous mettre d'accord sur une règle de comportement quelconque. Tu peux, bien sûr, demander s'il n'y a pas des exceptions, comme celles de personnalités éclairées qui sentent qu'elles n'ont pas besoin d'être "guidées" dans le choix du bien et du mal. Mais alors, je te le demande, ne verrait-on pas de très nombreuses personnes revendiquer ce droit exceptionnel pour elles-mêmes ?
Et quel en serait le résultat ?" (Le Chemin de la Mecque, Fayard, 1976, p. 179).
Objectifs de la révélation au regard de l'islam :
En islam, la révélation divine se veut donc une orientation ("lumière") venant confirmer et approfondir l'orientation naturelle ("lumière") que contient déjà le cœur humain (comme la spiritualité, les sentiments et aussi tout raisonnement fait avec leur accompagnement). La nécessité de cette lumière de la révélation se fait sentir parce que l'être humain, complexe, n'est pas qu'un cœur ou qu'une raison, et qu'il risque, sans le vouloir, de croire être les "lumières de sa raison orientée par son cœur" ce qui est en fait "les pulsions de ses intérêts personnels". Cette "autre lumière qu'est la révélation" vient donc approuver, approfondir et préserver les valeurs humaines en indiquant à l'homme les limites qu'il lui convient de respecter.
La révélation divine ne s’adresse donc à l’homme ni parce qu’il serait coupable de naissance, ni pour contredire ce qu'il voit et observe sur terre, ni pour lui interdire de profiter sainement des ressources terrestres, ni encore pour l’empêcher de tirer parti de sa raison. Selon la conception musulmane, la révélation divine est un message venant de Dieu, d'au-dessus du ciel étoilé au-dessus de moi, afin de confirmer et de parachever ce que me souffle mon cœur qui est en moi.
Sans la présence de la lumière de la révélation, l’homme risque de ne pas savoir gérer, voire de perdre l’orientation de la lumière de son cœur qui raisonne. A la recherche de réponses à ses questionnements, il risque fort de se mettre à imaginer, à croire à des superstitions et à des mythes, et à prendre ses désirs pour des réalités… "Ils ne suivent que leur imagination et ce que leur âme désire" (Coran 53/ 23).
A la recherche d'une orientation pour l'application de ses outils, il risque fort de tomber dans le "tout relatif", où tout peut être remis en question en fonction de bas intérêts. Assurément il trouvera parfois des réponses, mais parfois non. Ici il parviendra à la vérité, mais là non… Au fil du temps, il risque fort de se laisser guider par "les pulsions de ses désirs", croyant qu’il s’agit de "la voix de son cœur" ou l' "expression de sa plus haute et de sa plus pure rationalité", et à considérer alors bons et même nécessaires des choses qui lui font en réalité du tort... qui font du tort à sa santé physique, à sa santé mentale, à la cohésion sociale… "…Il se peut que vous n’aimiez pas quelque chose alors que c’est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu’elle est nocive pour vous" (Coran 2/216).
Caractéristiques de la révélation au regard de l'islam :
En islam, la Révélation ne vient rien ordonner qui soit contraire à l’humanité et aux caractéristiques physiques de l’homme : "Dieu veut vous éclairer, vous montrer les chemins des hommes d’avant vous et accueillir votre repentir. Dieu est omniscient et sage. Dieu veut accueillir votre repentir. Et ceux qui [ne] suivent [que] leurs désirs veulent que vous penchiez énormément. Dieu veut vous alléger [les obligations], car l’homme a été créé faible" (Coran 4/26-28).
"Dieu ne charge une âme que ce dont elle est capable" (Coran 2/286).
"Dieu veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté" (Coran 2/185).
Si l'islam demande à ce qu'on s'en tienne uniquement aux formes et aux modalités d'adoration communiquées par la révélation (Coran et Hadîths), il ne le demande en revanche pas en ce qui a trait aux affaires sociales et aux habitudes terrestres : ici il s'agit de respecter les limites (interdictions et ce qui est déconseillé) et les orientations (obligations et recommandations) qu'il est possible d'extraire en tant que principes à partir des prescriptions de l'époque du Prophète Muhammad. Car la révélation n'a pas comme objectif de contredire les découvertes de la raison. En revanche, l'application de ces découvertes est directement concernée par les limites que fixe la révélation dans les affaires sociales : elle leur permet tout ce qui est en-deçà de ces limites, en même temps qu’elle leur montre que ce qui va au-delà leur est nocif : "… Voilà les limites (fixées par) Dieu. Ne les dépassez pas…" (Coran 2/229).
"… Et celui qui dépasse les limites (fixées par) Dieu se fait du tort à lui-même…" (Coran 65/1).
Ainsi se comprend, en islam, le besoin et la place de la révélation dans la vie des hommes : la lumière de la révélation est donnée aux hommes de la part de Dieu pour confirmer et préserver la lumière naturelle de leur cœur, afin de les guider dans l'exercice quotidien de leur vie sur terre.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Est-ce le cerveau ou le cœur qui est le siège de la raison ?
04/12/2007 16:10

Est-ce le cerveau ou le cœur qui est le siège de la raison ?
Trois questions :
1) Que signifie le verset coranique : "des cœurs par lesquels ils raisonnent ou des oreilles par lesquelles ils écoutent" ?
2) Est-ce le cerveau ou le cœur qui est le siège de la pensée, de la réflexion et du raisonnement ?
3) Est-ce le cœur ou le cerveau qui est le siège des émotions, des sentiments et des qualités spirituelles ?
Réponse :
Ce qu'il faut dire d'emblée c'est que, même à discuter du lieu où elles se trouvent et des mécanismes par lesquels elles s'expriment, on ne peut nier l'existence chez l'homme des deux facultés de la "raison" et du "cœur".
En effet, ces deux termes renvoient à des réalités connues et répertoriées, quelle que soit leur localisation : dans la poitrine (le muscle cardiaque) ou dans le cerveau. Le terme "raison" désigne ainsi la faculté humaine de comprendre, de raisonner et de penser ;
le mot "cœur" exprime quant à lui la faculté d'aimer, de détester et d'émettre des critères éthiques.
Ce rappel effectué, nous pouvons maintenant aborder la question de la localisation de ces deux facultés que sont "le cœur" et "la raison"…
1) Est-ce le cerveau ou le cœur qui est le siège de la pensée, de la réflexion et du raisonnement ?
Cette question a fait l'objet, comme l'a rappelé an-Nawawî, d'une divergence d'avis bien connue entre les savants musulmans.
Un certain nombre de savants disent que la faculté de raisonnement se trouve dans le cœur (ici dans le sens de muscle cardiaque) et non dans le cerveau : il s'agit entre autres de Mujâhid, de Ibn Hajar (Fat'h ul-bârî, commentaire du hadîth n° 52 rapporté par al-Bukhârî), et, d'une façon plus générale, des savants de l'école shafi'ite (Shar'h Muslim, commentaire du hadîth n° 1599).
Plus récemment, un savant comme al-Albânî (mort en 1999) pensait de même : raisonner et penser, écrit-il, sont des actes du cœur qui se trouve dans la poitrine, et non du cerveau qui se trouve dans la boîte crânienne ; al-Albânî se fonde pour cela sur les versets suivants du Coran : "Ils ont un cœur (mais) ne comprennent pas par son moyen" (Coran 7/179).
"N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'avoir des cœurs par lesquels ils raisonnent, ou des oreilles par lesquelles ils écoutent ? Car ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent, mais s'aveuglent les cœurs qui sont dans les poitrines" (Coran 22/46).
Voyez, dit al-Albânî : ces versets disent bien que c'est le cœur qui comprend et qui raisonne ; or, souligne-t-il, le "cœur" ne peut être compris comme désignant le cerveau, car la fin du verset dit explicitement qu'il se trouve dans la poitrine (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, tome 6 p. 468).
D'autres savants pensent pour leur part que la faculté de penser, de comprendre et de raisonner se trouve dans le cerveau.
Parmi ces savants se trouve Abû Hanîfa (voir Shar'h Muslim, commentaire du hadîth n° 1599).
Et cet avis est également relaté de Ahmad ibn Hanbal ("Wa qad yurâdu bil-qalbi : bâtin ul-insân mutlaqan (...). Fa idhâ urîda bil-qalbi hâdhâ, fal-'aqlu muta'alliqun bi dimâghihî aydhan ; wa lihâdhâ qîla : "Inna-l-'aqla fid-dimâgh", kamâ yaqûluhu kathîrun min al-atibbâ', wa nuqila dhâlika 'an il-imâm Ahmad" : Majmû' ul-fatâwâ, Ibn Taymiyya, tome 9 p. 303).
J'ai questionné Cheikh Khâlid Saïfullâh au sujet du premier avis et de l'argumentation sur laquelle il repose, il m'a répondu en substance que d'une part il est aujourd'hui démontré scientifiquement que la faculté de raisonnement se trouve dans le cerveau, et que d'autre part il y a depuis les premiers siècles de l'Islam deux avis chez les savants. "Je pense donc que dire le contraire serait contraire à ce qu'a prouvé l'observation ("mushâhadé ké khilâf")" a-t-il conclu.
Comment, me direz-vous, comprendre alors les deux versets coraniques sur lesquels les tenants du premier avis ont fondé celui-ci ?
Nous allons y revenir dans les points 2 et 3, à travers les explications de al-Ghazâlî, de Shâh Waliyyullâh et de al-Jûzû.
2) Est-ce le cœur ou bien le cerveau qui est le siège des émotions, des sentiments et des qualités spirituelles ?
D'après les savants musulmans, d'après aussi les poètes et les mystiques occidentaux, c'est le cœur qui est le siège des émotions, des sentiments, des critères éthiques et des qualités spirituelles.
A cela des scientifiques occidentaux contemporains objectent que le cœur n'est qu'un muscle qui fait office de pompe envoyant le sang dans le reste de l'organisme. D'après ces scientifiques, c'est plutôt le cerveau qui est le siège de sentiments et de qualités ; et ce qu'on nommait auparavant "émotions" et "valeurs" n'est en fait que l'expression de gènes, d'hormones et de connexions entre neurones (comme l'a écrit Jean-Pierre Changeux)…
Mais en fait il faut nuancer ce propos. En effet, que le cœur soit un muscle servant à envoyer le sang dans tout le corps par l'intermédiaire des artères, on le sait en Occident depuis 1648 avec Harvey (en terre musulmane, la petite circulation du sang avait été mise en évidence 400 ans plus tôt, par Ibn an-Nafîs ; cf. "Le soleil d'Allah brille sur l'Occident", Sigrid Hunke, pp. 152-155).
Certes. Mais que le cœur soit une pompe pour le sang n'implique pas qu'il ne puisse pas être plus que cela.
– Déjà il faut dire que pour le savant musulman al-Ghazâlî, "le cœur" dont parlent le Coran et la Sunna en tant que siège des qualités n'est à proprement parler pas le muscle cardiaque mais l'âme humaine. Il écrit : "Lorsque nous employons le mot "cœur" dans cet ouvrage, nous n'entendons pas désigner [le muscle cardiaque]" (Al-Ihyâ', tome 3 p. 5) mais l'âme humaine (c'est ce qu'implique ce qu'il a écrit dans les lignes et les pages suivantes). Al-Ghazâlî souligne que quand "il est employé dans le Coran et la Sunna" également, le mot "cœur" désigne aussi l'âme humaine ; de plus, cette âme humaine y est parfois désignée par les termes : "le cœur qui se trouve dans la poitrine" (Idem, p. 7). Malgré tout, précise al-Ghazâlî, "il y a un lien particulier entre cette âme, qui est immatérielle, et le cœur physique" ; en fait, souligne-t-il, l'âme est liée à tout le corps, de même qu'elle donne des influx à tout le corps, mais son lien avec le cœur est de nature particulière (Al-Ihyâ', tome 3 p. 4 et p. 7).
"Les qualités, les critères éthiques, les sentiments, se trouvent dans l'âme" (voir Hujjat-ullâh il-bâligha, Shâh Waliyyullâh, tome 1 pp. 66-67) ;
or l'âme ayant un lien avec tout le corps mais particulièrement avec le cœur physique, ce dernier serait une sorte de réceptacle de ces qualités et sentiments.
Ces tentatives d'explications ne sont scientifiquement pas impossibles. Une américaine, Claire Sylvia, relate : "En 1988, alors que je suis presque mourante, atteinte d'une maladie grave et fatale, on m'ouvre la poitrine et on m'en extrait le cœur et les poumons. Dans une tentative désespérée de me sauver la vie, les médecins transplantent, dans cet espace vide et creux, les organes d'un jeune homme qui vient de mourir dans un accident de moto. (…) En me réveillant de l'opération, je pense que mon long voyage est enfin parvenu à son terme. En fait, il ne fait que commencer. Très rapidement, je sens que j'ai reçu bien davantage que simplement deux organes. Je commence à me demander si le cœur et les poumons transplantés ne portent pas en eux leurs propres inclinations et souvenirs. Je fais des rêves et constate des changements qui semblent suggérer que certains aspects de l'esprit et de la personnalité du donneur existent à présent à l'intérieur de moi" (Mon cœur est un Autre - Le miracle des greffes, le mystère de la mémoire cellulaire, Claire Sylvia, Jean-Claude Lattès pour la traduction française, 1998, pp. 13-14).
""Le cœur n'est rien d'autre qu'une pompe." Telle est la vision de la médecine contemporaine. Je précise "contemporaine" parce que jusqu'au XVIIè siècle, le cœur n'était pas du tout considéré comme une pompe. Dans l'Antiquité, on le voyait comme le centre de la sagesse et de l'émotion. (…) En 1648, lors d'une des plus importantes découvertes de l'histoire de la médecine, le médecin anglais William Harvey proclamait au monde que le cœur, au travers d'une série continuelle de contractions, pompait le sang qui circulait dans le corps pour revenir à sa source. Aujourd'hui personne ne le conteste, mais reconnaître l'évidence – à savoir que le cœur est une pompe – ne revient pas à affirmer que c'est uniquement une pompe. Comme nous le verrons, certains scientifiques croient que le cœur est peut-être bien davantage" (Idem, pp. 259-260). "Toute ma vie on m'a affirmé, en dépit des protestations des poètes et des convictions des mystiques, que le cœur humain n'était qu'une pompe. Une pompe incroyablement importante, certes, mais rien de plus qu'une machine monotone et indispensable. Conformément à ce point de vue, qui est celui généralement accepté par la médecine occidentale contemporaine, le cœur ne contient aucun sentiment et n'abrite aucune sagesse, aucune connaissance et aucun souvenir. Et si celui d'une personne a précédemment résidé dans le corps d'une autre, cela ne présente aucune signification ou implication particulière. Je croyais à ces idées, mais aujourd'hui je sais qu'il en va autrement. Peut-être y a-t-il d'autres façons d'envisager les choses. Peut-être certaines des nombreuses qualités attribuées au cœur depuis des siècles ne sont pas seulement métaphoriques. Même aujourd'hui, à une époque éclairée et scientifique, nous invoquons encore notre cœur pour décrire nos sentiments et nos valeurs. Lorsque l'amour meurt ou que la mort frappe, nous disons que notre cœur est brisé. Nous prenons à cœur ou nous n'avons pas à cœur de faire quelque chose. Si l'on est généreux, on a le cœur sur la main. Si l'on est insensible, on est sans cœur. Cœur pur, cœur gros, cœur sensible, cœur dur, cœur noble, cœur tendre, cœur d'or ou de pierre – la liste est longue. Ces expressions recèleraient-elles une vérité littérale ?
Même les cardiologues les plus conservateurs reconnaissent que la santé et le fonctionnement du cœur sont affectés par certaines réalités émotionnelles telles que la solitude, la dépression ou l'aliénation. Et s'il est communément accepté que l'esprit et le corps sont profondément liés, il n'existe pas autant d'images ou d'expressions se référant au foie, au pancréas ou même au cerveau" (Idem, p. 15).
– D'un autre côté, l'âme humaine semble être liée de façon particulière au cerveau aussi. Un savant musulman indien, Mujâhid ul-islâm Qâssimî, écrit : "On sait maintenant que la mort humaine est liée de façon essentielle à la mort du cerveau : la mort survient quand meurt la partie du cerveau que l'on nomme "le tronc cérébral". (…) L'arrêt des battements du cœur entraîne l'arrêt de la circulation sanguine, ce qui arrête l'irrigation du cerveau en sang. Sans être irrigué en sang, le cerveau ne peut demeurer vivant que quelques quatre ou cinq minutes. (…) Et lorsque le cerveau meurt, alors même si on maintient pour un moment les battements du cœur de façon artificielle, l'homme ne peut revenir à la vie. Au contraire du cas où le cerveau est vivant : même si les battements du cœur s'arrêtent pendant quelques minutes, du moment où le cerveau reste irrigué en sang [par une machine], alors l'être humain est toujours vivant" (Dimâghî mawt o hayât kâ mas'ala, p. 5). Mujâhid ul-islâm poursuit : "C'est pourquoi les médecins disent que le centre de l'âme humaine se trouve dans le cerveau (…) ; c'est le cerveau qui est le centre de la pensée, et c'est lui qui donne aux membres du corps les influx leur ordonnant de faire telle ou telle chose" (Idem). "On dit que c'est cette partie du cerveau [le tronc cérébral] qui est le centre de la conscience humaine" (Idem). Plus loin il écrit : "La mort survient quand le tronc cérébral meurt ; d'après les savants musulmans, elle survient quand l'âme quitte le corps. (…) On peut concilier ces deux perceptions en disant que l'âme, qui est immatérielle, n'est pas l'objet des investigations scientifiques de la médecine, contrairement au cerveau, qui, lui, est matériel. (…) L'âme agit sur le corps par l'intermédiaire du tronc cérébral, qu'elle prend comme centre. Mais quand le tronc cérébral meurt, l'âme le quitte" (Idem, pp. 7-8).
– Serait-il possible de proposer la synthèse suivante : d'un côté, comme l'a écrit Shâh Waliyyullâh, c'est dans le premier niveau de l'âme – confluent entre le corps et le niveau supérieur de l'âme – que se localisent les qualités et les sentiments profonds ; or, comme l'a écrit al-Ghazâlî, l'âme a un lien particulier avec le cœur physique ; le cœur serait donc une sorte de réceptacle des qualités et des sentiments. D'un autre côté, comme l'a écrit Mujâhid ul-islâm Qâssimî, l'âme a aussi un lien d'attache particulier avec le cerveau. Dès lors, l'explication pourrait-elle être la suivante : l'âme humaine agit sur le corps par l'intermédiaire du cerveau, mais tout ce qu'elle recèle en elle a pour réceptacle le cœur physique. L'âme serait donc liée de façon particulière au cerveau et au cœur. Cette synthèse est-elle possible ? Prière aux frères et sœurs compétents d'en faire une critique constructive.
3) Le cœur avec lequel l'homme raisonne :
Selon les explications citées ci-dessus, la faculté humaine du "cœur" n'est pas la même chose que celle de la "raison" : le cerveau est le siège de la pensée, tandis que le cœur est le réceptacle des sentiments et des qualités. Le Coran utilise cependant une formule originale, qui mêle les deux termes : il exhorte les hommes à avoir "un cœur par lequel ils raisonnent" : "N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'avoir un cœur par lequel ils raisonnent ou des oreilles par lesquelles ils écoutent ?" (Coran 22/46).
Comment comprendre cette formule ?
Pour al-Jûzû, le cœur et la raison ne sont en effet pas une seule mais deux facultés différentes.
Cependant, selon lui, le cœur et la raison ont chacun leur intelligence : comme le cerveau raisonne, le cœur a son intelligence propre ; les deux modes de raisonnement sont différents, mais ils ne sont pas antinomiques. Et le Coran exhorte donc les hommes à utiliser l'intelligence de leur cœur pour appréhender les choses de l'univers, comme ils utilisent d'habitude le raisonnement de leur raison pour le faire (voir Maf'hûm al-'aql wal-qalb fil-qur'ân was-sunna, al-Jûzû, pp. 275 et suivantes).
Pour Shâh Waliyyullâh également, le cœur et la raison ne sont pas une seule mais deux facultés différentes (Hujjat ullâh il-bâligha, tome 2 p. 235 et p. 273). Cependant, à la différence de al-Jûzû, pour Shâh Waliyyullâh seule la raison raisonne, et si le Coran et la Sunna attribuent parfois au cœur les qualités qui relèvent en fait d'autres facultés, c'est qu'ils utilisent parfois ce terme "cœur" d'une façon large (tassâmuh) : il s'agit de l'intérieur de l'homme [il est à noter que Ibn Taymiyya a également écrit la même chose, relatant que c'est là un des sens que revêt parfois le terme "cœur" : Majmû' ul-fatâwâ, tome 9 p. 303]. Le Coran et la Sunna attribuent donc au "cœur", dans un sens figuré, de nombreuses qualités, qu'il s'agisse de qualités qui sont réellement celles du "cœur" ou qu'il s'agisse en fait de celles de la "raison" ou encore de celles relatives aux pulsions corporelles naturellement présentes chez l'homme (Idem, p. 273).
Serait-il possible de proposer l'humble explication suivante : comme l'ont écrit Shâh Waliyyullâh et al-Jûzû, "cœur" et "raison" sont deux facultés différentes. Mais à la différence de ce que al-Jûzû a écrit et en conformité avec ce que Shâh Waliyyullâh a expliqué, seule la raison raisonne, tandis que le cœur, lui, est le réceptacle des sentiments et des qualités. Serait-il possible alors de dire que ce que ce verset demande à l'homme, c'est que lorsqu'il pense avec sa raison, il le fasse avec l'accompagnement de son cœur ; que sa raison agisse en s'orientant de ce que lui souffle en amont le cœur ?
En fait tout repose sur la compréhension de la particule "bâ'" ("bi") employée dans le verset : "qulûbun ya'qilûna bi hâ" :
l'explication de al-Jûzû semble reposer sur l'avis qu'il s'agit d'une particule exprimant le moyen ("ba' al-isti'âna") ; mais pourrait-il s'agir d'une particule exprimant l'accompagnement ("bâ' al-mussâhaba") ?
Selon l'explication de al-Jûzû, il serait question de raisonner par le moyen du cœur même. Dans le cas où il s'agirait d'une particule exprimant l'accompagnement, il serait question de raisonner par sa raison mais avec l'accompagnement du cœur. Ce n'est qu'une tentative d'explication.
Est-elle possible ?
Prière aux lecteurs et lectrices compétents d'en faire une critique constructive!
En tout état de cause et quelle que soit l'explication retenue, le résultat est le même. Est-ce que le cœur humain a son raisonnement propre, différent de celui de la raison, le verset exhortant alors les hommes à utiliser le raisonnement de leur cœur comme ils utilisent d'habitude celui de leur raison ?
Ou bien est-ce que seule la raison raisonne, le verset exhortant alors les hommes à raisonner par leur raison mais avec l'accompagnement de leur cœur ? Le Coran évite ce genre d'explications abstraites pour aller à l'essentiel et aborder le côté concret des choses. Et cet essentiel est de rappeler aux hommes que leur faculté d'appréhender les réalités du monde ne doit pas être l'œuvre d'une raison pure et froide, mais d'une intelligence du cœur… d'un "cœur par lequel ils raisonnent". Cette formulation fait apparaître une nouvelle dimension au raisonnement humain : il est demandé à l'homme d'avoir une intelligence active mais qui ne se limite pas à un côté des choses ; d'avoir une intelligence où la pensée et le sentiment se trouvent en interactivité ; d'avoir une intelligence où la réalité matérielle comme la réalité spirituelle sont prises en compte... Il est demandé à l'homme de développer en soi un mode de raisonner où la mécanique de la raison se trouve accompagnée par la chaleur des sentiments et de la spiritualité.
Des écrits de Ibn Taymiyya sur le sujet :
Après avoir proposé mon humble réflexion concernant le fait que l'âme est liée aussi bien au cerveau qu'au cœur, j'ai découvert que Ibn Taymiyya avait en fait écrit la même chose : "Wat-tahqîq anna-r-rûha – al-latî hiya-n-nafs – lahâ ta'aluqqun bi hâdhâ [al-qalb] wa hâdhâ [ad-dimâgh] ..." (Majmû' ul-fatâwâ, tome 9 p. 304). Je suis heureux d'avoir découvert cet écrit confirmant mon humble réflexion.
Wal-hamdu lillâh 'alâ dhâlik.
Concernant le fait que l'intelligence humaine est liée au cerveau comme au cœur, je n'ai pas trouvé un texte approuvant ce que j'ai proposé, à savoir que la particule bâ' exprimerait peut-être l'accompagnement et que seul le cerveau raisonne, mais l'islam lui demande demande à l'homme de le faire avec l'accompagnement du cœur ; l'écrit de Ibn Taymiyya sur le sujet ne confirme pas ce que j'ai proposé, néanmoins le résultat concret est assez proche : lui écrit que le raisonnement est lié à la fois au cerveau et au cœur : "Wa mâ yuttassafu min-al-'aql bihî, yata'allaqu bi hâdhâ wa hâdha" (Majmû' ul-fatâwâ, tome 9 pp. 303-304).
4) L'oreille par laquelle l'homme écoute le message venant du dessus du ciel étoilé :
L'intelligence du cœur, c'est la Lumière que l'homme possède en son intérieur, c'est sa source d'orientation éthique. Mais pour protéger, développer et orienter cette Lumière première, il est une autre Lumière : celle qu'offrent à l'homme les textes de la révélation. Pourquoi le besoin d'une seconde lumière en plus de la première. Ces deux lumières orientent l'homme pour sa spiritualité, pour l'organisation des liens entre lui et ses semblables, pour l'éthique liée aux différents aspects de sa vie.
Le verset que nous avons cité ci-dessus évoque, à côté de la Lumière que l'homme reçoit de son cœur qui raisonne, la Lumière que l'homme reçoit en écoutant le message : "N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'avoir un cœur par lequel ils raisonnent ou des oreilles par lesquelles ils écoutent ?" (Coran 22/46).
Le savant Ibn Qayyim a employé ces deux termes : "al-'aql" – raisonner par son cœur – et "as-sam'" – écouter et comprendre le message de la révélation – pour décrire respectivement les aspects des croyances et de l'éthique que l'homme possède de façon quasi-naturelle, et la révélation qui vient protéger, orienter et développer cette perception globale. Ainsi, selon Ibn ul-Qayyim, le fait qu'il doit se produire un jour où les hommes seront justement rétribués pour leurs actes relève, en son essence, de ce que l'intelligence du cœur ressent intuitivement ("al-'aql") ; la façon exacte selon laquelle cette rétribution se déroulera ne peut cependant être comprise qu'en se référant aux textes de la révélation ("as-sam'") (cf. Hâdi-l-arwâh, pp. 499 et 502).
Selon ce commentaire, "al-qalb alladhî yu'qal bih" désigne donc bien la Lumière intérieure de l'homme, et "as-sam'" désigne bien la Lumière de la révélation. De la même façon, Ibn Taymiyya emploie de nombreuses fois la formule "ad-dalâ'ïl al-'aqliyya wad-dalâ'ïl as-sam'iyya" : "les preuves provenant de la raison et les preuves provenant de ce qu'on entend", c'est-à-dire de la révélation.
"Il y a là un rappel pour celui qui a un cœur ou qui a prêté l'oreille tout en étant témoin" (Coran 50/37). Si ce verset parle du cœur, il s'agit du cœur qui raisonne – car le terme "qalb" ici employé a été commenté par : "'aql" (cf. Tafsîr Ibn Kathîr) –, donc de l'intelligence du cœur, conformément au verset 22/46.
"Et ils diront : "Si nous avions écouté ou si nous avions raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise"" (Coran 67/10).
Ici encore, il est question non pas du raisonnement de la raison pure et froide mais de l'intelligence du cœur (conformément au verset 22/46 et suite aux explications proposées plus haut). Ici encore, écouter concerne le fait d'écouter ce que Dieu a révélé (cf. Tafsîr Ibn Kathîr, commentaire de ce verset).
Les propos de deux philosophes et leur pendant en islam :
Blaise Pascal disait : "Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point". Chaque musulman(e) peut dire : "Le cœur a ses raisons, qui sont différentes de celles de la raison : la raison ne pouvait produire d'elle-même ces raisons du cœur ; en revanche elle peut et doit les connaître, les reconnaître et les prendre en considération."
Le philosophe allemand Kant disait : «Deux choses ne cessent de remplir mon cœur d'admiration et de respect plus ma pensée s'y attache et s'y applique : le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale en moi »
Chaque musulman(e) peut quant à lui(elle) dire :
«Deux lumières ne cessent de remplir mon cœur d'admiration et de respect plus ma pensée s'y attache et s'y applique : la lumière qui est en moi, qui est celle de mon cœur avec l'accompagnement duquel je raisonne ; et la lumière qui vient d'au-dessus du ciel étoilé au-dessus de ma tête, qui est la lumière de la révélation divine .» Dieu dit : "Lumière sur lumière" (Coran 24/35).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Extraction du principe et vérification de sa présence dans les cas nouveaux
04/12/2007 15:34

Extraction du principe et vérification de sa présence dans les cas nouveaux
La raison dispose de trois outils pour extraire des textes les règles applicables aux cas qui :
-soit n'y sont pas absolument stipulés,
-soit ne l'y sont pas explicitement,
-soit ne l'y sont pas directement :
a) le takhrîj ul-manât ;
b) le tanqîh ul-manât ;
c) le tahqîq ul-manât.
"Manât" signifie "pivot" et désigne la même chose que "'illa", à savoir : la cause à laquelle la règle est attachée (note de bas de page sur p. 731 de Irshâd ul-fuhûl).
1) Le "tahqîq ul-manât" : effort de recherche de la présence de la cause dans les cas particuliers (juz'iyyât), en vue de réaliser un "qiyâs ush-shumûl", une "analogie d'englobement, c'est-à-dire une application, à ces cas, de la règle liée à cette cause :
Les textes ont communiqué une règle (hukm), et soit la cause qui la commande ('illa) figure aussi dans les textes, soit elle a été extraite par un juriste qui est d'avis de la légitimité de l'extraction de la cause. Dès lors, la règle s'applique à tous les cas qui appartiennent à la catégorie qu'elle concerne (et qui sont donc particuliers par rapport à l'ensemble que cette catégorie constitue) (id'râj ul-juz'î tahta-l-kullî). C'est pourquoi on appelle cet outil : "tahqîq ul-manât", c'est-à-dire : "vérification de (la présence de la) cause".
L'application du "tahqîq ul-manât" conduit à ce qu'on nomme : le "qiyâs ush-shumûl", ou "analogie par englobement" (qu'il ne faut pas confondre avec le "qiyâs ul-'illa", qui, lui, résulte de l'application du "takhrîj ul-manât", que nous allons voir plus bas). (Qiyâs ush-shumûl mabniyyun 'ala-stiwâ' il-afrâd al-mundarija tahta-l-kulliyy, baynamâ yakûnu qiyâs ul-'illa mabniyyan 'alâ wujûdi mumâthala bayn fardayn).
La vérification de la présence de la cause juridique (tahqîq ul-manât) dans un cas particulier (juz'î) consiste à vérifier si cette cause commandant l'application de la règle donnée (hukm) est bien présente dans ce cas particulier (juz'î), et si ce cas ne recèle pas un "wasf fâriq", un élément qui induit une différence entre les cas (juz'iyyât) dont il est établi qu'ils sont inféodés à la règle, et ce cas-ci (juz'î), en sorte que ce dernier tombe en fait sous le coup d'une autre règle et non de celle-ci.
On peut voir cette vérification à l'œuvre dans les deux dimensions suivantes…
1.1) Chercher à établir ce qu'il en est du réel, en vue de vérifier si la règle – qui est de l'ordre du général – est applicable ou non à tel élément du réel – élément qui, lui, relève de l'ordre du particulier – :
les textes disent qu'en cas de contrainte à faire un acte normalement interdit (autre que le fait de tuer quelqu'un), il devient autorisé de faire cet acte, mais que l'on doit garder en son cœur la croyance que cela est en soi interdit. Tout cas qui relève de la contrainte tombe sous le coup de cette règle. La raison du mujtahid s'emploie alors à chercher si tel cas particulier (par exemple l'existence d'une loi rendant obligatoire sur le citoyen ce que le musulman considère interdit pour lui) remplit toutes les conditions de la contrainte, afin que la règle concernant celle-ci lui soit applicable.
Dans l'école hanafite, la règle en vigueur est que l'élément qui était en soi illicite à la consommation mais qui a ensuite subi une transformation complète (istihâla) n'est plus illicite (lire notre article sur le sujet ; lire aussi la réponse de Mufti Ebrahim Desai). Maintenant, concrètement, la gélatine d'origine porcine, ou qui est issue d'un animal dont la chair est en soi licite mais qui n'a pas été abattu rituellement, remplit-elle toutes les conditions de la transformation complète en sorte qu'elle tombe sous le coup de la règle qui s'y refère ? ou bien ne remplit-elle pas toutes ses conditions, en sorte qu'elle ne cesse pas de relever de la règle relative aux constituants du porc, ou encore du bovin qui n'a pas été abattu rituellement ? Ceci demande un "tahqîq ul-manât".
Selon une règle musulmane bien connue, il est interdit à un musulman de porter ce qui constitue le symbole d'une autre religion ou d'une autre idéologie. Si la règle s'applique universellement à par exemple un crucifix, qu'en est-il d'autres vêtements ?
Il s'agit de relier la règle à la réalité du contexte dans lequel le musulman vit : tel vêtement, dans tel pays et à telle époque, constitue-t-il le symbole de non-musulmans, ce qui l'inféode à cette règle de "hurmat ut-tashabbuh", ou bien ne constitue-t-il pas le symbole d'une autre religion, ce qui l'inféode à la règle de la permission originelle (avec bien sûr le respect des autres règles : de pudeur etc.) ?
Toutes ces questions ne relèvent nullement du "qiyâs ul-'illa" mais du "qiyâs ush-shumûl" ; et ce dernier nécessite une "tahqîq ul-manât".
1.2) Accoler l'élément en question à telle catégorie ou à telle autre ("ilhâq ul-juz'î bi hâdha-l-jins aw dhâka") ?
Le fait est qu'il est certaines règles qui sont applicables lorsque l'élément relève de telle catégorie, mais non s'il relève de telle autre, et ce même si la cause juridique (illa) semble y être présente. Ainsi, "ta'lîq ut-tamlik bi-l-khatar" est la cause juridique extraite de l'interdiction de l'élément "maysir", mentionné explicitement dans les textes ; tout autre élément dans lequel on retrouve cette cause est interdit, même s'il n'est pas stipulé dans les textes ; cependant, ce le sera si l'élément relève lui aussi de la catégorie "mu'âwadhât", et non s'il relève de la catégorie "tabarru'ât". De façon plus générale, adopter un élément non mentionné dans les sources, cela est impossible si l'action dans lequel cet élément s'insère relève de la catégorie "al-'ibâdât" et non de celle "al-'âdât".
Les textes ont interdit au musulman ou à la musulmane qui est déjà en état de sacralisation liée au pèlerinage (ihrâm) de se parfumer ; le fait de le faire entraîne la nécessité de s'acquitter d'une expiation ("kaffâra" : "dam" ou "sadaqa", selon les cas). Le fait pour ce(tte) musulman(e) de consommer un aliment dans lequel on a ajouté ce qui constitue également un parfum en soi – comme le safran oriental – tombe-t-il sous le coup de la nécessité de s'acquitter d'une expiation – car le principe actif de la nécessité de payer une expiation est l'existence d'une trace parfumée –, ou bien ne tombe-t-il pas sous le coup de cette règle car relevant de la catégorie "aliments" ? Les écoles shafi'ite et hanbalite sont du premier avis. L'école hanafite, elle, dit que le fait d'ingérer du safran oriental pur tombe sous le coup de la règle, tandis que le fait qu'il ait été mélangé à d'autres ingrédients puis que le tout ait été cuit le range sous la catégorie "aliments" même si son parfum subsiste : la règle n'est alors pas applicable ; enfin, s'il a été simplement mélangé à des aliments sans avoir été cuit, si on ressent son parfum, il est mauvais de consommer cet aliment en état de sacralisation, mais si on le fait il n'y aura aucune expiation à payer, car cela relève de la catégorie "aliments" (cf. Awjaz ul-massâlik, 6/437).
2) Le "tanqîh ul-manât" : effort de dégagement, parmi tous les éléments présents dans le cas précis où la règle a vu le jour, du pivot (manât) auquel la règle est liée :
Ibn Taymiyya écrit à propos du "tanqîh ul-manât" : "Le Prophète a émis une règle à propos d'une personne précise (mais) on sait que la règle n'est pas spécifique à cette personne ; on cherche alors à dégager le pivot de la règle afin de connaître quelle est la catégorie à propos de laquelle le Prophète a voulu émettre cette règle. (…)
Le Prophète (saw)a dit à celui qui est entré en état de sacralisation vêtu d'un manteau et enduit de khalûq [un parfum fabriqué à partir de safran oriental] : "Enlève ce manteau et lave-toi pour faire disparaître la trace de kahlûq". [Le tanqîh ul-manât revient ici à se poser la question suivante :] Le Prophète a-t-il ordonné (à cet homme) de se laver parce que la personne en état de sacralisation ne doit pas, après l'entrée en état de sacralisation, conserver sur elle une trace de parfum mis avant l'entrée dans cet état – comme le pense Mâlik – ; ou bien parce qu'il est interdit à l'homme [mais non à la femme] de (s'enduire de) safran oriental [en toutes circonstances], ce qui revient à dire que ce hadîth n'interdit pas à la personne en état de sacralisation de conserver sur elle, après l'entrée en état de sacralisation, une trace de parfum mis avant l'entrée dans cet état – comme le pensent les trois autres référents ? Et si on retient la première possibilité, ce hadîth est-il (ou non) abrogé par le fait que Aïcha a enduit le Prophète de parfum lors du pèlerinage d'Adieu ?" (Majmû' ul-fatâwâ 19/15-16).
Ibn Taymiyya donne un autre exemple : "Au bédouin qui avait eu des relations intimes avec son épouse pendant le ramadan, le Prophète(saw) ordonna de donner l'expiation [affranchir un esclave, jeûner deux mois, ou nourrir soixante pauvres]. Il est évident que cette règle n'est pas spécifique à ce bédouin. Il est évident que ce n'est pas non plus son caractère de bédouin ou d'arabe qui est le pivot de la règle, ni même que la femme avec qui il a eu des relations intimes était son épouse. (…) Par contre, (la question qui se pose est :) est-ce que le pivot du caractère obligatoire de l'expiation est le fait qu'il a annulé son jeûne du ramadan par des relations intimes précisément, ou bien le fait qu'il l'ait annulé tout court ? Ash-Shâfi'î et Ahmad (d'après l'avis le plus connu de lui) sont du premier avis ; Mâlik, Abû Hanîfa et Ahmad (d'après une des opinions relatées de lui) (…) du second. Ensuite ,Mâlik considère que la règle est applicable par rapport à tout ce qui annule le jeûne, tandis que Abû Hanîfa pense qu'elle ne l'est que par rapport à ce qui annule le jeûne et qui est de même nature que ce qui est spécifié dans le hadîth : il pense donc que le fait d'avaler volontairement un caillou ou un grain (annule le jeûne mais) ne rend pas l'expiation obligatoire. (…)" (Majmû' ul-fatâwâ 19/15-16).
Le "tanqîh ul-manât" consiste à établir que tel élément, non mentionné dans le texte, relève de la même règle que l'élément qui y est, lui, mentionné, car le premier ne présente aucune qualité susceptible d'induire, par rapport à la règle en question, une différence entre lui et le second élément (l'élément faisant l'objet d'une mention explicite dans le texte) ("ilghâ' ul-fâriq" ; "ithbât anna-l-fâriqa-l-mawjûda fi-l-maskût 'anh bi-n-nisbati li mawrid in-nass 'adîm ut-ta'thîr bi-n-nisbati li-l-hukm"). Le "tanqîh ul-manât" mène donc à un "élargissement" du champ de la règle par rapport au strict contexte dans lequel elle avait été stipulée.
"L'avis pertinent est que cela [le tanqîh ul-manât] ne relève pas du qiyâs à propos duquel la divergence d'opinion est possible", conformément à l'avis notamment de l'école hanafite (Ibid. 22/329). Le "qiyâs à propos duquel la divergence d'opinion est possible" est le "qiyâs ul-'illa", encore appelé : "qiyâs ut-tamthîl", qui est lié au "takhrîj ul-manât" que nous allons voir ci-après… (Il est probable que l'école qui est de l'avis différent de celui que Ibn Taymiyya qualifie ici de "pertinent" soit l'école shafi'ite : le fait est que celle-ci dit que le "qiyâs fî ma'na-n-nass" – qui semble être un autre nom de ce "tanqîh ul-manât" – relève du "qiyâs ul-'illa" : ,
3) Le "takhrîj ul-manât", ou effort d'extraction de la cause en vue de rendre possible le raisonnement par analogie ("qiyâs ul-'illa", encore appelé : "qiyâs ut-tamthîl", "qiyâs ul-ashbâh", ou "qiyâs un-nazâ'ïr") :
Il faut lire ce raisonnement par analogie, "qiyâs ut-tamthîl", et découvrir les différents types de causes juridiques ('illa) : l'effort d'extraction "takhrîj ul-manât" ne concerne que les deux types de cause juridique ('illa) qui ne sont pas explicitement donnés dans les textes.
Par contre, quand la cause juridique est explicitement mentionnée dans les textes ('illa mansûssa), même les savants qui sont opposés au "qiyâs ul-'illa" considèrent qu'ici, le juriste doit appliquer la règle qui est attachée à cette cause aux cas qui ne sont pas stipulés dans les textes mais où se retouve la même cause : le fait est que ces savants considèrent qu'ici il s'agit non d'une "qiyâs ul-'illa" proprement dite mais du fait d'agir selon le texte même, donc d'une "qiyâs ush-shumûl" ("min bâb il-'amal bi-n-nass, lâ min bâb il-qiyâs" : d'après Irshâd ul-fuhûl 702).
Notes :
1) Quand la règle est claire mais qu'une certaine hésitation existe à propos d'un élément donné : appartient-il à la catégorie visée par la règle ou non ?
Les textes ont interdit d'utiliser un récipient en or ou en argent pour y manger ou boire. Ceci constitue la règle (hukm). La règle s'applique, cela est certain, au récipient en or ou en argent massif. Cependant une certaine hésitation voit le jour à propos du récipient qui, lui, est seulement recouvert d'une fine pellicule d'or ou d'argent : tombe-t-il sous le coup de cette règle, ou bien – dans le cas où la règle ne concernerait que les récipients en or ou argent massif – de la règle de la permission originelle? Cf. Subul us-salâm 1/39.
Un hadîth stipule que le meurtrier n'héritera pas de celui ou celle qu'il a tué ; dans le cas d'un parricide, par exemple, le meurtrier n'héritera rien. Cette règle s'applique, cela est certain, à celui qui a tué volontairement et sans être en état de légitime défense. Cependant, une certaine hésitation apparaît à propos de celui qui a tué involontairement (qatl ul-khata'), comme lors d'un accident de chasse, etc. : tombe-t-il lui aussi sous le coup de cette règle, ou bien – la règle ayant comme objectif de dissuader d'assassiner pour toucher rapidement l'héritage – fera-t-il exception au point où il pourra toucher sa part d'héritage ?
L'école malikite est du premier avis, les trois écoles du second.
Ce genre d'"individu" relève d'une part de la généralité du terme mais, d'autre part, présente une spécificité par rapport aux autres cas qui, eux, en relèvent de façon évidente, au point que l'on est amené à se demander s'il relève lui aussi de la même règle que ces autres cas. Cela engendre une sorte de "khafâ'" – un "flou" – ; de là le terme "khafî", donné par des spécialistes des fondements de la jurisprudence hanafite : le texte est – en soi – "zâhir" – mais est aussi – et par rapport à ce genre de cas – "khafî" ("wa huwa idhâ kâna-l-lafzu zâhir ad-dalâla – fî haddi dhâtih –, wa lâkin 'aradha lahû shay'un min al-khafâ' – bi sababi ghayri lafzih, mithla an yakûna li ba'dhi afrâdihî wasfun yumayyizuhû 'an ghayrih – awqa'a shub'hatan fî dukhûli dhâlika-l-ba'dh fî 'umûm il-lafz"). Et la question de chercher à établir si la règle stipulée dans les textes s'applique ou non à ce cas individuel quelque peu particulier aussi, c'est une forme d'ijtihad (Ussûl ut-tashrî' al-islâmî, p. 232).
Seulement je ne sais pas si cet effort de recherche, cet ijtihad, relève bien de l'un des trois outils mentionnés dans cet article ?
Et si oui, cela relève-t-il du tahqîq ul-manât ou bien du tanqîh ul-manât ?
Je ne sais pas. Prière aux frères et sœurs compétents de me faire part de leurs connaissances sur le sujet…
2) Al-Bukhârî et le qiyâs ul-'illa :
Al-Kashmîrî a écrit à très juste titre – et contrairement à ce que d'autres savants pensent à ce sujet (cf. Fat'h ul-bârî 13/356) – que al-Bukhârî, dans son Jâmi' sahîh, kitâb ul-i'tissâm, tarjama n° 7, 8 et 12, veut bien dire qu'il considère le "qiyâs ul-'illa" comme un outil non valable.
Al-Kashmîrî écrit ensuite : "Peut-être diras-tu :
"Comment al-Bukhârî peut-il dire qu'il ne considère pas le qiyâs comme un outil valable alors que son livre est empli de qiyâs ?"
Je dirai alors : "Peut-être qu'il n'agit que selon le tanqîh ul-manât"." (cf. Faydh ul-bârî 4/507-508).
3) Quels sont les points communs et les points de différence entre le "qiyâs ul-'illa" et le "tanqîh ul-manât" ?
Pour Ibn Taymiyya, la différence entre le "qiyâs ul-'illa" et le "tanqîh ul-manât" est que la question de réaliser ou non le premier se pose quand, à la lecture du texte, le mujtahid perçoit qu'il est en soi possible que la règle soit spécifique aux cas stipulés dans le texte, comme il est en soi possible qu'elle soit commune à d'autres cas aussi (jâza "ikhtisâsu mawrid in-nass bi-l-hukm" wa "jâza an yakûna-l-hukmu mushtarakan bayn mawrid in-nass wa ghayrih" : Majmû' ul-fatâwâ 22/327) ; par contre, le second concerne le cas où la règle a été stipulée à propos d'un événement particulier et qu'il est évident pour le mujtahid que la règle ne lui est pas spécifique ("qadhiyya mu'ayyana wa lâ khafâ'a anna-l-hukma layssa mukhtassan bihâ" : Ibid.).
L'explication de al-Kashmîrî est la suivante : "qiyâs ul-'illa" et "tanqîh ul-manât" reviennent à rendre la règle, spécifiée dans le texte d'application, plus générale que ce que la stricte littéralité du texte indique. Cependant, c'est dans ce mouvement de généralisation opéré par la raison du mujtahid qu'il y a une différence entre les deux : dans le cas du tanqîh ul-manât, ce mouvement se fait de l'intérieur même du texte, la raison cherchant, par sa seule appréhension du texte, à dégager l'élément du texte qui entraîne la règle, et la catégorie à laquelle cet élément se rattache ; dans le cas du qiyâs ul-'illa, en revanche, c'est après avoir été confrontée à des questions nouvelles dans la réalité extérieure que la raison cherche, dans les textes, des cas auxquels elle pourrait rattacher les nouveautés par analogie. Le mouvement est donc inverse (cf. Faydh ul-bârî 4/507-509).
La distinction entre les deux ne semble pas (wallâhu a'lam) toujours aisée.
4) Règle générale et éléments particuliers :
Le lecteur aura remarqué qu'on a beaucoup parlé d'éléments particuliers et de règles générales : il y a en fait l'élément particulier (juz'î), le sous-ensemble immédiat auquel cet élément se rattache (naw'), la catégorie immédiate à laquelle ce sous-ensemble appartient (jins qarîb), la catégorie plus lointaine (jins ba'îd), etc. : ainsi, la consommation de la chair du chien est interdite : cette règle est relative à un élément particulier (juz'î), le chien ; cet élément se rattache au sous-ensemble plus général (naw') de "quadrupède carnivore" : le Prophète a interdit la consommation de chaque élément de cet ensemble ("nahâ 'an akli kulli dhî nab min as-sibâ'…") : il s'agit, d'après Abû Hanîfa, des animaux carnivores, et d'après ash-Shâfi'î, des animaux féroces (Nayl ul-awtâr 8/262).
La consommation du porc est interdite : il s'agit d'un élément particulier, et non rattachable à un sous-ensemble immédiat (naw'), interdit lui aussi. Par contre, cet élément particulier recouvre plusieurs individus (af'râd), tous également interdits : le porc domestique, mais aussi le sanglier, le phacochère, le babiroussa…
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
«'Alim, savant en sciences d'islam, pas tenu d'être 'Abid, adorateur de Dieu ?»
04/12/2007 14:55

«'Alim, savant en sciences d'islam, pas tenu d'être 'Abid, adorateur de Dieu ?»
Question :
Il y a un «Hadîth »où le Prophète (sallallâhu 'alayhi wa sallam) a parlé de "la valeur du 'âlim par rapport au 'âbid".
Je ne comprends pas ce hadîth : le 'âlim ( celui qui est versé dans les sciences islamiques )ne serait-il donc pas tenu, lui, d'être un 'âbid (quelqu'un qui pratique la 'ibâdah, l'adoration de Dieu) ?
Réponse :
Voici le Hadîth :
"La valeur du 'âlim par rapport au 'âbid est comme celle de la pleine lune sur les étoiles"
(at-Tirmidhî 2682, Abû Dâoûd 3641).
Un autre Hadîth existe qui parle lui aussi de :"la valeur du 'âlim par rapport au 'âbid" et la compare à autre chose (at-Tirmidhî 2685).
Par "'âlim", dans ce Hadîth, le Prophète (sur lui soit la paix) n'a pas voulu désigner "celui qui est versé dans la connaissance des croyances et des normes musulmanes, mais ne pratique même pas le minimum d'actes d'adoration de Dieu".
Le Prophète(saw) n'a pas voulu désigner pareil homme, car le 'ilm (savoir religieux ) qui n'entraîne pas la pratique ('ibâdah )n'est pas un 'ilm digne de ce nom selon le Prophète(saw) . Ainsi, il dit un jour à propos de quelque chose : «Cela se passera au moment où disparaîtra le 'ilm".»
Ziyâd ibn Labîd, un Compagnon alors présent, lui dit : «Comment le 'ilm pourrait-il disparaître alors que nous lisons le Coran et l'enseignons à nos enfants qui, à leur tour l'enseigneront à leurs enfants, et ainsi de suite jusqu'avant la fin des temps ?»
Le Prophète(saw) lui dit : «Ziyâd, je te considérais comme un des hommes de Médine ayant le plus de compréhension».
Puis il lui dit qu'il y avait bien des Gens du Livre qui lisaient la Torah et l'Evangile mais ne pratiquaient pas ce qui s'y trouve (Ibn Mâja, 4048).
On voit ici que le fait d'avoir le 'ilm mais de ne pas pratiquer ce que celui-ci enseigne a été considéré comme un "non-'ilm" par le Prophète (saw).
De même, par "'âbid", dans ce Hadîth, le Prophète n'a pas voulu désigner "celui qui pratique de nombreux actes d'adoration de Dieu – 'ibâdah – mais ne connaît même pas le minimum obligatoire de croyances et de normes musulmanes". Le Prophète n'a pas voulu désigner une telle personne, puisque celle-ci néglige l'obligation – donc l'acte d'adoration aussi – d'acquérir la connaissance des croyances de base et des normes qui concernent sa situation. Une personne qui aura désobéi à Dieu en ayant négligé cela ne peut être 'âbid, quoi qu'elle dise et quoi qu'elle puisse faire croire aux autres.
En fait, dans ce hadîth, il est question de deux personnes qui, d'un côté, accomplissent toutes deux le minimum requis – obligatoire sur chaque musulman –, et ce en terme d'acquisition de connaissances autant que de pratique des actes d'adoration ; et qui, d'un autre côté, se sont toutes deux "adonnées" à l'approfondissement d'une "branche" différente de l'islam : en sus de ce qui est obligatoire, pendant une grande partie de son temps libre, l'une se consacre à l'approfondissement des connaissances en sciences de l'islam, tandis que l'autre s'adonne aux prières, jeûnes, etc. facultatifs (nâfila). C'est à propos de ces deux personnes que le Prophète a dit ce que vous avez cité : ces deux personnes font le bien et il est naturel que ces deux types de personnes existent au sein de la Communauté musulmane ; cependant, la première personne a une valeur supérieure à la seconde.
Ceci est l'explication que Alî al-Qârî a fournie. Il écrit qu'il est question, dans ce hadîth, de "al-ghâlibu 'alayh il-'ilm" et de "al-ghâlibu 'alayh il-'ibâdah" (Mirqât ul-mafâtîh 1/280). Il décrit le premier comme étant : "al-âlim bi-l-'ulûm ish-shar'iyya, ma'a-l-qiyâm bi farâ'ïdh il-'ubûdiyya" (1/281) et : "alladhî yaqûmu bi nashr il-'ilm, ba'da adâ'ïhî mâ tawajjaha ilayhi min al-farâ'ïdh wa-s-sunan il-mu'akkada" (1/280). Et il définit le second comme : "al-mutajarrad li-l-'ibâdah, ba'da tah'sîli qad'r il-fardh min al-'ulûm" (1/281) et : "alladhî yasrifu awqâtahû bi-n-nawâfil, ma'a kawnihî 'âliman bi mâ tassihhu bihi-l-'ibâdah" (1/280).
Un autre hadîth à comprendre selon le même principe :
C'est la même chose pour les Hadîths concernant les différentes portes du Paradis : "Dans le Paradis il y a huit portes (...)" (al-Bukhârî 3084) ; "Celui qui aura été des gens de la prière sera appelé par la porte de la prière" ; et le Prophète a ensuite affirmé le même propos concernant d'autres types de personnes et d'actions (al-Bukhârî 3466, Muslim 1027). Alî al-Qârî de souligner, ici aussi, qu'il s'agit de personnes qui (auront pratiqué toutes les actions obligatoires mais) se seront adonnées particulièrement à telle action plus que telle autre. Les termes qu'il a employés sont : "man ghalaba 'alayhi tilka-l-'ibâdah wa man istak'thara minhâ kulluhâ bi wasf iz-ziyâda" (Mirqât ul-mafâtîh 4/201).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Pourquoi l'islam est-il spiritualité mais aussi règles juridiques ?
04/12/2007 14:52

Pourquoi l'islam est-il spiritualité mais aussi règles juridiques ?
L'islam rappelle à l'homme qu'il lui faut vivre sur terre et satisfaire ses besoins terrestres, corporels et matériels, en tenant compte de ses exigences spirituelles, qu'il lui faut vivre sur terre avec et devant Dieu(swt). Il lui rappelle que le premier niveau de son âme ("ar-rûh al-hayawânî" ou "an-nafs al-hayawânîyya" ) est le confluent du corps et du "cœur" ("ar-rûh al-insânî" ou "an-nafs al-insânîyya" ou "al-qalb"), et donc, de façon naturelle, le siège parfois de tentations, donc de choix, donc de la reconnaissance du bien et du mal.
Du bien si les besoins du corps sont satisfaits en tenant compte de ceux du "cœur". Du mal s'ils le sont de façon excessive, c'est-à-dire sans prise en compte des exigences de ce "cœur". "Pourquoi, alors, entend-on souvent dire, l'islam mêle-t-il du juridique au religieux ?
Pourquoi indique-t-il non pas seulement une droiture du cœur, mais aussi des règles pour le culte de Dieu(swt)? et même pour les relations des hommes entre eux ?"
La question paraît d'autant plus pertinente qu'on remarque que des musulmans oublient parfois, pendant la prière, la présence du cœur pour ne se focaliser que sur l'observance rituelle des règles.
La réponse de Shâh Waliyyullâh :
Le savant indien du XVIIIè siècle Shâh Waliyyulâh ad-Dehlawî a répondu à cette question comme suit : «Fondamentalement, le devoir des hommes vis-à-vis de Dieu est qu'ils l'adorent et ne lui désobéissent point. Leur devoir ,les uns vis-à-vis des autres, est qu'ils établissent des relations de bonté et de solidarité, sans jamais se faire du tort, sauf au cas où la nécessité globale y oblige (comme pour toutes les peines prévues pour les criminels) »(Hujjatullâh il-bâligha, 1/264).
Un cadre indiquant comment accomplir ces devoirs aussi bien verticaux qu'horizontaux était cependant nécessaire. Car sinon, «certains hommes se seraient suffi de ce qui ne suffit pas : ils auraient prié :
-sans récitation du Coran,
-ou sans faire de demande à Dieu(swt).
-Sans horaires indiqués, certains auraient considéré comme suffisant très peu de prières ou très peu de jeûnes.
-Sans savoir lesquels des actes de la prière sont obligatoires et lesquels facultatifs, il n'auraient pas, en cas d'oubli d'un de ces actes, si leur prière est valable ou pas.
Bref, il fallait que soient indiqués aux hommes non seulement l'existence de ces devoirs, mais également un cadre leur montrant comme les accomplir, avec des horaires, des actes et des conditions d'accomplissement »(Op. cit., 1/256-257).
Il en va de même pour les affaires de la vie : à quoi dire oui, à quoi dire non ? Confier cette tâche au seul cœur ou à la seule raison aurait conduit exactement à ce que veut éviter l'islam .
Il fallait donc bien un cadre d'ensemble, un cadre juridique orientant les musulmans afin qu'ils ne tombent pas dans le "tout relatif". A cet effet, les règlements stipulés par le Coran ou les Hadîths rendent obligatoire, ou bien recommandent, ou permettent, ou déconseillent, ou interdisent. En même temps que la lettre d'un règlement particulier (far'), il existe, au-delà, un principe juridique qui en est la cause (illa) et qui en commande l'application. Tout règlement particulier ayant été formulé à propos d'un acte de l'époque du Prophète (sur lui la paix) ne l'est donc que parce que cet acte renferme un principe : c'est la cause (illah) de ce règlement.
Les limites et les orientations juridiques qu'induisent ainsi ces principes entendent indiquer aux hommes lesquels de leurs actes corporels et matériels trahissent, et lesquels au contraire ne trahissent pas leurs exigences spirituelles et / ou sociales.
Et c'est ainsi que, selon le savant indien Shâh Waliyyullâh, le droit musulman a comme objectif de préserver, dans l'exercice humain de la vie quotidienne, essentiellement deux choses : les exigences humaines spirituelles et sociales. Le savant andalou ash-Shâtibî a pour sa part poussé plus loin l'extrapolation, et a établi que le droit musulman avait comme objectif de préserver cinq choses : la spiritualité, la personne humaine, l'intellect, les biens et la filiation.
Respect des normes (fiqh) et présence du cœur (ihsân) :
Le risque, maintenant c'est vrai, est que les musulmanes et les musulmans prennent le moyen pour l'objectif, et se contentent d'une application superficielle et littéraliste des règles sans aller au-delà vers plus de profondeur. Car Shâh Waliyyullâh écrit aussi : «Les actions que dicte l'islam sont à appréhender sous deux angles complémentaires. Le premier est leur aspect visible, sous lequel elles sont réglementées par le droit musulman. Le second est leur lien avec les qualités du cœur , en sorte que leur mise en pratique conduise effectivement à une droiture intérieure» (Op. cit., 2/176).
Les deux dimensions entrent donc en jeu et sont complémentaires :
- les moyens (la mise en pratique des règles apportées par le Prophète(saw) et devant conduire à l'objectif)
- l'objectif (la proximité de Dieu(swt), la droiture du cœur, la justice sociale).
Le respect des règles, et la droiture du cœur... ou la dimension juridique, et la dimension "morale-spirituelle"... le Prophète (sur lui la paix) tenait compte simultanément de ces deux aspects de la réalité humaine : "Dieu ne regarde pas vos visages (s'ils sont laids ou beaux) ni votre fortune (si elle est abondante ou pas), mais Il regarde votre cœur et vos actions." (rapporté par Muslim).
Ainsi, d'un côté, il enseignait le moyen, à savoir les règles juridiques permettant de construire un jeûne (sawm) : les règles concernant l'annulation du jeûne, les repas avant l'aube et après le coucher du soleil, etc. D'un autre côté, il rappelait l'objectif de ce moyen : "Celui qui (malgré son jeûne) ne délaisse pas la parole du mal et l'action du mal, Dieu(swt) n'a pas besoin qu'il délaisse nourriture et boisson." (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim)
C'est bien là le sens de "islam", qui signifie "soumission", sous-entendu "à Dieu", ce qui exprime bien le fait que l'on recherche non seulement la droiture du cœur, mais un accord réel et complet avec ce que Dieu veut.
Ne pas aller vers la profondeur, l'intériorité, et se contenter de l'aspect visible, c'est ne pas se conformer à ce modèle. Mais ne pas vouloir de l'aspect visible, le moyen, tel que défini par les sources de l'islam, c'est refuser le modèle du Messager de Dieu(saw).
Car celui qui prétend vouloir se passer des moyens que Dieu(swt) et Son Messager(saw) ont établis pour atteindre le but voulu, ne refuse-t-il pas quelque part de se soumettre à Dieu (swt)?
Shâh Waliyyullâh écrit en substance : «Dieu veut-il de nous que nous respections les règlements que Lui et Son Messager nous ont dictés, ou bien veut-il de nous uniquement la droiture du cœur, qui est en somme l'objectif de ces règlements ? Autrement dit, celui qui, sans raison valable, délaisse une des prières (salâts) obligatoires, mais, pendant toute l'horaire de cette prière, ne cesse de penser à Dieu(swt), fait-il un bien ou un mal ?
La vérité est que Dieu veut de nous que nous respections les règlements juridiques qui nous ont été dictés, mais ce d'une façon profonde, en sorte qu'ils nous mènent à la droiture du cœur. Quant à celui qui sait que Dieu a ordonné de faire la prière à telle heure pour penser à Lui, puis la délaisse sans raison valable en prétextant qu'il n'a pas cessé de penser à Dieu sans faire la prière, n'est-ce pas en fait une sorte de refus de ce que Dieu agrée ?" (Op. cit., tome 1 pp. 268-271)
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux) !   

|
|
|
|
|
|